En 1945, La France Agricole naît presque concomitamment avec l’adoption du statut du fermage. Quel a été l’impact de ce premier texte fondateur de la politique foncière française telle que nous la connaissons aujourd’hui ?
Ce statut constitue la première pierre de la construction de l’exploitation familiale à la française, à savoir une cellule productive de deux UTH (unité travailleur humain, aujourd’hui unité de travail annuel, UTA) qui va permettre au pays de retrouver rapidement son autosuffisance alimentaire.
Le statut du fermage a contribué à cet effort productiviste sans précédent en assurant au preneur la stabilité grâce à une durée minimale du bail de 9 ans et un droit à son renouvellement, en lui permettant de pérenniser son exploitation à travers le droit de cession du bail dans la sphère familiale, et en lui offrant une certaine forme de promotion sociale avec l’accès à la propriété à travers le droit de préemption.
Très vite, la modernisation de l’agriculture française, alors portée par une nouvelle génération d’agriculteurs, entraîne une diminution importante du nombre d’exploitants que l’État et les syndicats agricoles veulent encadrer avec de nouveaux outils.
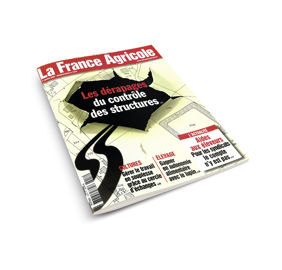
Quels sont ces outils ?
Avec la grande loi d’orientation de 1960 sont institués les Safer (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) qui ont pour vocation d'intervenir sur le marché foncier par l’acquisition et la redistribution de terres dans un but d’installation de jeunes agriculteurs, mais aussi au profit d’exploitants souhaitant consolider leur exploitation. Dès 1962, une loi complémentaire à celle de 1960 confie aux Safer un droit de préemption pour peser davantage dans la réalisation de leurs missions, dont celle de lutter contre la spéculation foncière.
« Il a souvent été reproché aux Safer de ne pas installer suffisamment d’agriculteurs mais elles ont aussi contribué à ce que les petites exploitations atteignent un seuil de viabilité »
Il ne faut pas s’y tromper. Au départ, la Safer est d’abord là pour accompagner ce mouvement de modernisation des exploitations et de départ massif à la retraite d’agriculteurs – la fameuse « révolution silencieuse ». Il a souvent été reproché aux Safer de ne pas installer suffisamment d’agriculteurs mais elles ont aussi contribué à ce que les petites exploitations atteignent un seuil de viabilité, condition de leur survie.
Cette loi créera également une législation sur le cumul et les réunions d’exploitations, l’ancêtre du contrôle des structures, ainsi qu’une nouvelle forme de société civile agricole, le Gaec, dont les principes de participation exclusive aux travaux et d’un homme pour une voix vont permettre de concilier le modèle agricole français avec le phénomène sociétaire.
Et ensuite comment ces outils ont-ils évolué ?
Dans les années soixante-dix, les organisations professionnelles agricoles ont conscience que l’acquisition du foncier constitue toujours une charge financière excessive pour les exploitants et notamment les jeunes agriculteurs. Ils considèrent qu’il est préférable d’investir dans l’outil de travail, également gourmand en capitaux. C’est la raison pour laquelle deux lois du 31 décembre 1970 créent respectivement le groupement foncier agricole (GFA) et le bail rural à long terme. Ils permettent de réaliser des montages souvent familiaux pour faciliter la stabilité du preneur en place. Ces outils ont fonctionné et fonctionnent toujours, malgré le reproche fait aux GFA d’une difficulté d’en sortir. Aussi, certains appellent aujourd’hui à réformer le GFA en élargissant son objet social pour englober de nouvelles activités, comme la production d’énergie, et en l’ouvrant davantage aux investisseurs, à l’instar des groupements fonciers forestiers investisseurs.
Le prix des terres en France est plus bas que chez nos voisins européens. Est-ce en raison de ces outils de régulation mis en place ?
Oui pour partie. La spéculation foncière est freinée par l’épée de Damoclès du droit de préemption de la Safer et, dans une moindre mesure, par le contrôle des structures. Le marché du foncier est également un marché essentiellement animé par l’acquisition des terres par les fermiers. Ces derniers bénéficiant de la protection du statut du fermage, ils limitent l’arrivée d’investisseurs qui pourraient tirer les prix vers le haut. Les raisons sont également économiques. La faible création de valeur par les agriculteurs limite la hausse des prix du foncier. Mais toutes les régions ne sont pas à la même enseigne. Les zones d’élevage ou intermédiaires ne connaissent pas les hausses de prix du nord du Bassin parisien ou de certaines régions viticoles très prisées comme la Bourgogne.
« C’est à partir des années quatre-vingt avec les réformes successives de la Pac que commence la nouvelle ère de l’entreprise agricole. »
Mais un foncier agricole à bon marché n’a pas que des avantages. Cela contribue à un mouvement d’artificialisation plus marqué que chez nos voisins européens, dont on a pris récemment conscience et contre lequel on tente aujourd’hui de lutter.
Il faut savoir qu’à euro constant, le prix des terres a connu une baisse importante de la fin des années soixante-dix à la fin des années quatre-vingt-dix, avant de bénéficier d’une hausse continue mais modérée depuis le début des années 2000. L’évolution de la Pac et ses aides découplées n’y sont pas étrangères.
De même, c’est à partir des années quatre-vingt avec les réformes successives de la Pac que commence la nouvelle ère de l’entreprise agricole.
Comment les adieux à l’exploitation familiale se sont traduits dans la législation ?
Nous trouvons les prémices d’un basculement de l’exploitation agricole vers l’entreprise agricole dans les années quatre-vingt avec la création de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL). L’organisation de la production sous la forme sociétaire, la possibilité de mettre son bail à la disposition d’une société, la transformation de la règlementation des cumuls en contrôle des structures sont autant d’éléments qui illustrent cette bascule. Nous entrons dans une approche de projet d’entreprise agricole avec de nouveaux schémas directeurs départementaux des structures.
« Ce vent de libéralisme souffle ensuite sur la France avec la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006. »
Les réformes successives de la Pac, qui ont démantelé les outils de maîtrise de la production et ont mis fin aux prix garantis, donnent de plus en plus de latitude aux exploitants pour choisir leur production. C’est aussi cela qui fait basculer les exploitations dans l’ère de l’entrepreneuriat et du contrat, non sans difficultés d’ailleurs comme les lois Egalim en attestent encore aujourd’hui. Les agriculteurs sont en prise directe avec le marché, duquel ils doivent à présent tirer leur revenu (qu’il soit local, national ou international, bio ou sous indication géographique…). Une philosophie dont le point d’orgue est la réforme de la Pac de 2003 avec le découplage des aides directes et la fin programmée des quotas de production (en lait, en betteraves). Ce vent de libéralisme souffle ensuite sur la France avec la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006. Le législateur de 2006 veut « faire évoluer l’exploitation agricole vers l’entreprise agricole ». Pour ce faire, il desserre notamment l’étau du contrôle des structures et crée deux instruments nouveaux : le fonds agricole et le bail cessible hors du cadre familial, respectivement calqués sur le fonds de commerce et le bail commercial.
Deux outils qui ne trouvent pas son public…
Ils font un flop pendant 15 ans. Mais aujourd’hui le bail cessible monte en puissance car il permet de sécuriser des montages financiers où les prix de reprise des fermes sont importants. Nous avons aussi aujourd’hui une partie des propriétaires qui ont davantage un profil d’investisseur que de potentiel repreneur. Ils recherchent donc une meilleure rentabilité pour leur capital foncier. Et le bail cessible d’au moins 18 ans avec sa majoration de fermage de 50 % permet d’assurer une meilleure rémunération du bailleur.
« C’est une incroyable opportunité pour l’entreprise agricole identifiée comme la solution à de nombreux enjeux sociétaux. »
L’entreprise agricole est alors une entreprise comme les autres ?
C’est par l’effet du marché que l’exploitation agricole est devenue une entreprise à part entière. Elle l’est d’autant plus aujourd’hui qu’elle est saisie, comme toutes les autres entreprises, par les mêmes enjeux de développement durable et, plus encore, car elle est en prise directe avec le vivant et a une fonction nourricière, ce qui reste sa spécificité. Mais en se banalisant, l’entreprise agricole s’intègre complètement dans les attentes de la société, ce qui oblige les agriculteurs et agricultrices qui sont à leur tête de rendre davantage compte de leurs pratiques en matière environnementale ou de bien-être animal. C’est d’ailleurs une incroyable opportunité pour l’entreprise agricole identifiée comme la solution à de nombreux enjeux sociétaux, environnementaux et climatiques. Mais pour ça, il faut aussi l’aider.
Comment ce verdissement se traduit-il dans les textes ?
Cette montée en puissance des considérations environnementales en agriculture date des années quatre-vingt-dix. Ce mouvement est depuis lors continu avec la prise en compte de l’environnement dans le statut du fermage mais aussi dans les outils de régulation du foncier, notamment avec de nouvelles missions d’ordre environnemental confiées aux Safer.
« Le droit de l’environnement s’occupe de plus en plus d’agriculture. »
C’est la loi du 13 octobre 2014 qui entérine cette nouvelle trajectoire. En consacrant l’agroécologie comme modèle de production à suivre pour l’agriculture française, elle oblige à faire évoluer les pratiques agricoles, à concilier agriculture productive et protection de l’environnement. C’est ainsi qu’apparaît notamment le bail rural à clauses environnementales.
Dans le même temps, le droit de l’environnement s’occupe de plus en plus d’agriculture en exigeant une protection accrue des ressources nécessaires à la production agricole, à commencer par l’eau.
Quelles évolutions des outils de régulation du foncier peuvent-elles être imaginées ?
La régulation moderne se cherche encore. La loi du 23 décembre 2021, portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires, dite Sempastous du nom du député qui en fut le rapporteur, a créé un nouveau contrôle de cession des parts sociales de sociétés foncières et agricoles. Aujourd’hui, la régulation est donc assurée par trois outils : le contrôle des structures, les Safer et la loi Sempastous. C’est trop ! Pour une meilleure efficacité et une meilleure lisibilité de la norme de la part des acteurs économiques, il faudra refondre l’ensemble de ces outils.
« À terme, je pense que la régulation sera confiée à un seul organisme. »
Faut-il alors simplifier la régulation, selon vous ?
Il y a la nécessité de fusionner le contrôle des structures, les Safer et le contrôle de la loi Sempastous (NDLR : qui sera opérationnel dès le 1er avril 2023). Nous devrions être en capacité demain d’avoir un contrôle global du projet agricole, de l’entreprise, qui dépasse les questions de surfaces. Cela permettrait de se concentrer sur la qualité du projet. Il peut y avoir des projets sur des surfaces importantes totalement pertinents. À terme, je pense que la régulation sera confiée à un seul organisme. Le fait que les Safer instruisent les dossiers de concentration excessive issus de la loi Sempastous constitue un premier indice. Mais un même outil peut-il réguler et intervenir sur le marché ? La question reste ouverte et les positions divergent.
Et notre bon vieux statut du fermage dans tout ça, doit-il aussi évoluer ?
Il faut rendre de nouveau le bail rural attractif. Le statut a tellement bien rempli son œuvre de protection de l’exploitation du fermier qu’aujourd’hui le propriétaire ne s’y retrouve plus et est devenue la partie faible au contrat. Il y a eu un renversement. Or, il ne faut jamais oublier que ceux qui portent le foncier de la ferme France sont d’abord les propriétaires privés.
Il faut réenchanter le bail rural et ça passe par un nouvel équilibre des prérogatives de chaque partie, à savoir au moins une meilleure rémunération pour le propriétaire et, pour le preneur, une plus grande facilité de transmission de ses baux et, donc, de son entreprise. Ce point est d’autant plus important que les transmissions au sein du cercle familial vont reculer à la faveur de transmissions au profit de personnes non issues du milieu agricole, qu’il faut réussir à intégrer dans nos schémas d’entreprise. La question de l’ouverture de la cessibilité du bail est un grand enjeu qui, je le regrette, semble absent des réflexions sur la future loi d’orientation agricole promise cette année. Aujourd’hui, le bail rural a besoin que souffle sur lui un vent de liberté contractuelle pour permettre aux parties de mieux s’adapter aux transitions qui sont à l’œuvre.
Souverainetés alimentaire et énergétique, protection des ressources et de la biodiversité, contribution à l’atténuation du changement climatique : plus que jamais, le foncier agricole est au cœur des grands enjeux contemporains.








