Dans le village de Boujailles, dans le Doubs, parler du « bon vieux temps » agace. « Ma mère trouvait que ce temps avait été bien trop dur pour les agricultrices », se souvient Jeannette Gros. À quatre-vingts ans, celle qui fut exploitante agricole et qui œuvra pour l’évolution des statuts des femmes en agriculture notamment à la tête de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) de 1997 à 2005, s’étonne du retour en force de certaines tâches.
« Ma mère était née en 1900, elle n’avait aucune nostalgie pour la fabrication du pain. Elle disait : « C’est de l’esclavage ». Les femmes de cette époque ne disposaient d’aucun répit entre leur famille et le travail de la ferme qu’elles partageaient du matin au soir. » Ses parents ont aussi tout entrepris pour que leurs quatre filles n’empruntent pas leur chemin. « Ma mère nous disait toujours : « Il faut que vous ayez une formation pour vous en sortir ». Nous avons donc étudié et travaillé à côté. »
Jeannette Gros intègre dans le même temps la Jec, Jeunesse étudiante chrétienne, et ses sœurs, la Jac, Jeunesse agricole chrétienne. « Cela fait souvent sourire aujourd’hui, mais ce furent des « écoles » de promotion essentielles pour les jeunes des campagnes. J’adhérais au mouvement CMR, Chrétien en milieu rural. Les échanges y étaient profonds, ça m’a aidé à prendre des responsabilités. »
1968, côté campagne
Contre toute entente, la benjamine de la fratrie, Jeannette, décide en 1968, après avoir enseigné le français de revenir sur la ferme familiale. « Mes parents n’étaient pas enthousiastes : « C’est un peu dommage », me disaient-ils. Mais ils n’avaient pas de successeurs, mes sœurs étaient établies, ils devenaient âgés et avaient besoin d’être accompagnés. Dans l’histoire de l’agriculture, les retraites ne datent que de 1952 et l’assurance maladie, de 1961. »
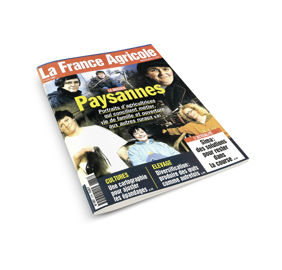
Pour se lancer, Jeannette Gros adhère au syndicat du CDJA, le Centre départemental des Jeunes agriculteurs, puis elle intègre la commission féminine de la FDSEA du Doubs. En 1980, le statut de « conjointe participant aux travaux » pour les femmes est mis en place. Il donne accès à une retraite forfaitaire de 228 euros par an.
« Dans le même temps, on cotisait très peu, se souvient Jeannette Gros. Mais ça n’était pas satisfaisant. Nous avons donc entrepris de mettre en place le statut de conjointe collaboratrice pour celles qui n’étaient ni salariées, ni associées. Cela concernait 1 100 agricultrices. La plupart avaient la cinquantaine, il fallait qu’elles terminent leur carrière dans de meilleures conditions. Mais, jamais une seconde, je n’ai pensé que ce statut très critiqué aujourd’hui, serait maintenu jusqu’à nos jours. »
Le couple en question
Si le statut a évolué, les retraites des agricultrices sont restées faibles : « Il fallait non seulement oser prendre ces statuts, mais aussi lutter pour l’augmentation des retraites. Le statut ne nous enrichissait pas. Quand on est passé de « conjoint participant aux travaux » à conjointe collaboratrice, il y a eu la possibilité de racheter des points. Beaucoup de femmes l’ont fait. Certains conseillers disaient aussi : « Il ne faut pas que vous payiez trop de cotisations pour pouvoir jouer sur les investissements ».
L’agricultrice a souvent servi de variable d’ajustement. Ça arrive encore. » L’ancienne présidente de la MSA s’inquiète aujourd’hui du retour des femmes sans statut sur les fermes. « On peut avancer avec d’autres idées, mais il ne faut pas retomber dans les erreurs du passé. On ne peut plus être esclave de son métier. Les agricultrices ont le droit de se former, d’avoir accès aux loisirs, d’élever leurs enfants, de souffler… Dans les lycées agricoles, on parle d’investissements, de techniques… mais jamais du statut de la femme sur l’exploitation.
Le fait d’être célibataire, mariée ou pas, change également beaucoup de choses. Avant, on reprenait une ferme à vie. Ces temps sont révolus, ils ont d’énormes conséquences. Ces sujets doivent être abordés à l’école. Ça fait partie de la formation. »








