L’histoire est bien connue. Lors de la conférence de Stresa en 1958, dans les ruines d’une Europe qui a faim, Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas vont jeter les bases de ce qui deviendra la première Politique agricole commune en 1962. Plusieurs décisions fortes sont alors prises. La mise en place de barrières tarifaires aux frontières, un projet de libre circulation des produits à l’intérieur de la Communauté et surtout, une politique de soutien des prix pour les productions agricoles des pays membres.
Un investissement très efficace
Pour la jeune Communauté européenne, l’investissement est lourd, mais très efficace pour dynamiser la productivité agricole. En 1968, un homme, Sicco Mansholt juge que la population agricole est trop importante et que la taille des exploitations est trop faible pour permettre une modernisation rapide. Vice-président de la Commission européenne chargé de l’agriculture, Sicco Mansholt va élaborer ce qui sera la première réforme de la Pac.
Pour Yves Petit, professeur de droit public et directeur du Centre européen universitaire de Nancy, c’est une première entorse au projet initial. « Dans le plan Mansholt on parle de grandes fermes et de modernisation, et c’est déjà en contradiction avec la conférence de Stresa et la ligne directrice qui avait été adoptée à l’époque » précise-t-il. Les préconisations de Sicco Mansholt furent drastiques : réduire le nombre d’agriculteurs de 5 millions et diminuer la surface agricole de 5 millions d’hectares.
Sus à la surproduction
La production continue d’augmenter et quand la consommation et l’exportation ne suffirent plus, c’est l’Europe qui devint acheteur public. Les années soixante-dix verront ainsi apparaître les fameuses « montagnes de beurre », métaphore célèbre pour décrire la surproduction laitière. Plusieurs scénarios sont alors imaginés, mais ce sont les quotas laitiers qui furent retenus et mis en place en avril 1984.
Un volume européen était alors fixé puis réparti entre les États membres. Les effets de ces quotas laitiers se ressentiront partout en Europe, mais c’est en France que les chiffres auront été les plus spectaculaires. Entre 1983 et 1985, l’Hexagone a perdu 23 % de ses exploitations laitières. Pour les grandes cultures, les stabilisateurs budgétaires limiteront les volumes à prix garantis et les agriculteurs furent incités à mettre des terres en jachères.
Le tournant de 1992
Les produits agricoles européens à bas prix couplés aux barrières aux frontières du vieux continent, irritent depuis plusieurs années ses partenaires commerciaux et concurrents. Lors des négociations de l’Uruguay Round qui précéda la création de l’OMC (organisation mondiale du commerce), l’agriculture était au cœur des divergences entre États-Unis et Europe. Sur le marché intérieur, la facture continue de s’alourdir pour soutenir les prix mais les revenus stagnent. Le commissaire à l’Agriculture de l’époque, Ray Mac Sharry travailla donc à une nouvelle réforme de la Pac qui sera un véritable bouleversement. Il trancha progressivement dans les prix garantis et amorça le principe des aides directes à l’hectare ou à l’animal.
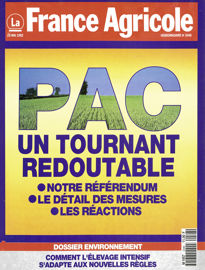
Pour freiner un peu plus la production, les jachères incitées devinrent obligatoires. « La Pac est née en 1962, mais le changement de cap c’est 92. C’est la réforme qui change complètement le système. On ne soutient plus les prix et on donne des aides », rappelle Yves Petit. La suite de l’histoire de la Pac a continué sur la même trajectoire. De nouvelles baisses des prix de soutien, accompagnées de compensations via des aides directes. Une importante nouveauté fut introduite en 1999 avec l’apparition du deuxième pilier de la Pac, dédié au développement durable.
Une Pac plus verte
En 2003, l’Europe a pris un nouveau tournant et décidé de découpler les aides de la production tout en augmentant le budget lié au développement rural. Mais c’est aussi lors de cette réforme que la notion de conditionnalité apparue. Un cahier des charges environnemental et de bien-être animal sera dorénavant imposé aux agriculteurs. France et Allemagne se mirent également d’accord pour un serrage de vis budgétaire sur la période d’application de cette nouvelle Pac. Une décision lourde de conséquences en plein agrandissement de l’Union européenne pour Yves Petit. « Je pense que Jacques Chirac s’est trompé en se mettant d’accord avec Gerhard Schrœder sur le maintien du budget de la Pac, car ce n’était plus pour 15 États membres, mais pour 25 » regrette-t-il.

L’Europe embrasse alors un agenda plus vert et ce sera plus marqué dans la réforme de 2013. Des aides directes pour les pratiques favorables à l’environnement ou au climat sont introduites. L’emploi et l’élevage sont davantage soutenus tout comme les jeunes agriculteurs. De multiples fonctions qui rendent difficile la tenue des objectifs initiaux pour Yves Petit. « La Pac est un peu devenue la bonne à tout faire du droit de l’Union Européenne. On lui en demande toujours plus sans que son budget augmente », observe-t-il.
Cette réforme, comme celle de cette année avec les Plan stratégiques nationaux, témoignent des conséquences du traité de Lisbonne de 2007. La gestion désormais partagée entre les États membres et l’Union Européenne pour la politique agricole soulève une question pour son avenir : restera-t-elle commune ?








