La productivité des cultures a fortement progressé ces dernières décennies. « Le rendement du blé tendre est passé en France de 35 q/ha dans les années 70 à 70-80 q/ha aujourd’hui, chiffre Rémi Bastien, directeur général de Limagrain Vegetable Seeds et vice-président de l’UFS (1). En colza, il est passé de 25 q/ha à 35 q/ha, et en maïs grain de 50 à 90 q/ha. »
Cette évolution n’est pas imputable à 100 % au progrès génétique car elle s’est accompagnée d’une amélioration des pratiques culturales, des apports en engrais et des produits phytos. « Si on voit sur les céréales une certaine stagnation des rendements sur les 10 dernières années, ceci est principalement lié aux évolutions du climat mais aussi à la baisse des moyens de production disponibles », estime-t-il. Le gain génétique reste néanmoins tangible dans le temps, d’environ 1 % par an en moyenne, grâce aux progrès des méthodes d’amélioration des plantes.
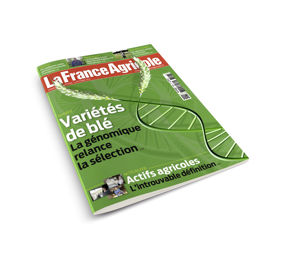
Variétés homogènes
Le premier tournant fut l’utilisation de la sélection généalogique visant à regrouper dans une même lignée, des gènes favorables de parents différents. « Avant guerre, les blés cultivés étaient des variétés populations, très hétérogènes, décrit André Gallais, professeur honoraire d’AgroParisTech et membre de l’Académie d’agriculture de France. Les travaux de Vilmorin ont conduit à extraire de ces populations les meilleures lignées, ce qui a permis la commercialisation de variétés homogènes, permettant à l’agriculteur de mieux connaître ce qu’il sème. »
Une autre évolution marquante est le développement des hybrides, à partir des années 70. Le maïs a servi de plante modèle mais cette technique s’est ensuite développée pour le tournesol ou la betterave. En colza, « les sauts technologiques ont été importants avec l’arrivée des premiers hybrides au début des années 2000, confirme Rémi Bastien. Ceci a permis d’accroître les rendements tout en proposant des résistances aux bioagresseurs ».

Séquençage des génomes
Les techniques de marquage moléculaire ont permis de faire un autre grand bond en avant, à partir de 1985. Puis, le séquençage des génomes (celui du maïs en 2009, 2013 pour la tomate et 2019 pour le blé) a permis l’essor de la sélection génomique, à partir des années 2000-2010. « Elle vise à prédire la valeur génétique de plantes candidates à la sélection, en limitant le nombre de générations évaluées au champ », explique André Gallais.
Cela a permis de gagner en précision sur l’identification des gènes d’intérêt et dans les stratégies de croisement. L’arrivée des nouvelles techniques d’édition génomique (NBT) pourrait encore offrir de grands pas en avant. « Il s’agit d’outils permettant d’être encore plus précis et de gagner du temps en créant davantage de diversité sans apport de gènes extérieurs à la plante, » insiste Rémi Bastien. Le sort des NBT dans l’UE doit être examiné d’ici l’été par Bruxelles.
"La biologie cellulaire, le génotypage, le phénotypage digital, la biostatistique, la bio-informatique et l’intelligence artificielle sont autant d’outils qui permettent aux chercheurs d’être plus efficaces, plus précis et aussi de gagner du temps", complète Rémi Bastien. Le rendement est resté le principal critère de sélection mais au fil du temps on y a ajouté des caractères de stabilité comme la résistance aux bioagresseurs.
La diversification des gammes de précocité a aussi permis aux cultures de remonter plus au Nord. Des améliorations significatives sont aussi observées dans la tolérance aux stress hydriques et thermiques, l’efficience à l’azote, la vigueur au départ, la qualité technologique…
(1) Union française des semenciers.








