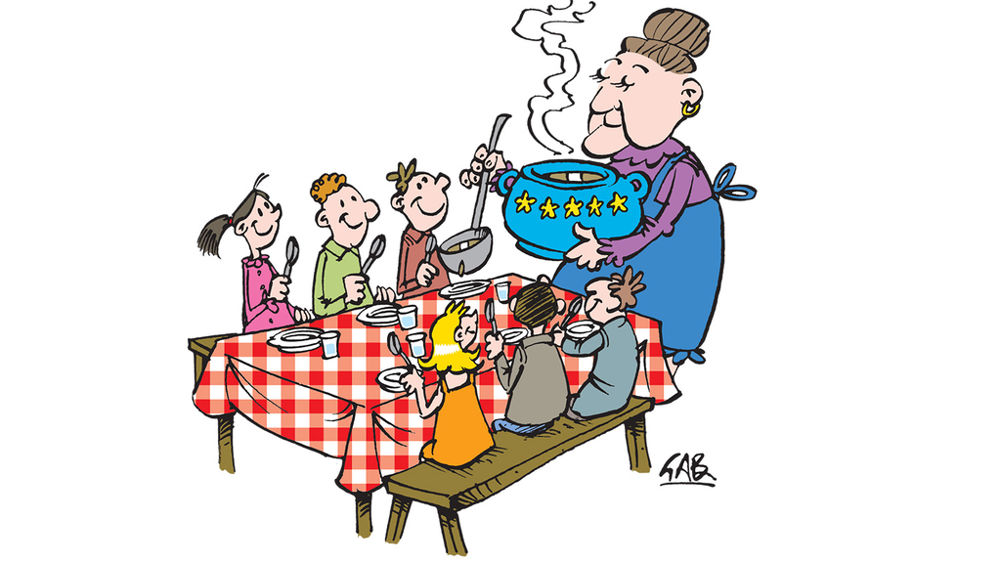Dans les jours qui suivent la mise en place du traité de Rome, le 1er janvier 1958, l’éditorialiste de La France agricole annonce que le journal instaure désormais une page (la dernière) à l’Europe. « C’est la page la plus importante de notre journal, écrit-il le 23 janvier 1958. Votre ferme est maintenant une exploitation européenne. Pensez-y et cultivez “l’esprit européen”. » Il ajoutait : « Il serait vain de construire les institutions du Marché commun sans les doter de l’esprit capable de les animer. Il n’y aura pas de Marché commun s’il n’y a pas d’esprit commun. » Ces pages perdureront pendant des décennies et, aujourd’hui, l’actualité européenne est toujours largement traitée.
Dès avant la signature du traité de Rome, La France Agricole consacrait de nombreux articles à la construction européenne, sous la plume de Georges Bréart, économiste chargé des questions européennes à l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture (APCA) et collaborateur régulier du journal. Ainsi, le 19 janvier 1951, il anticipe les enjeux de l’organisation de l’agriculture européenne : « Il y a pour les uns des sacrifices à consentir, pour les autres des avantages à partager, une confiance mutuelle à s’accorder et à mettre à l’épreuve », insistant sur le fait que libéralisation des échanges et organisation des marchés devaient aller de pair. « Une coopération européenne par la production et la vente des produits, écrit-il, n’est pas synonyme d’une impitoyable concurrence entre des égoïsmes sacrés. »
Lors des débats sur le Marché commun à l’Assemblée nationale, l’éditorialiste écrit le 20 juin 1957 : « Cet avenir est fatalement plein d’incertitudes et aussi de risques pour l’agriculture française comme pour le pays tout entier », insistant sur la nécessité d’associer les organisations professionnelles à la préparation et à la mise en œuvre de cette Pac, selon lui, condition déterminante du succès de l’entreprise.
Les nombreux éditos et articles qui vont suivre durant la première moitié des années 1960 abordent des thèmes récurrents : les inégalités de revenus entre l’agriculture et l’industrie, la préférence communautaire (pas toujours respectée), la conquête de nouveaux débouchés, l’érosion humaine. À ce propos, Sicco Mansholt, le commissaire européen à l’Agriculture, estimait en 1961 que huit millions d’agriculteurs européens devaient se préparer à quitter leurs exploitations dans les quinze prochaines années. Ce qui suscitera une vive réaction de la part de l’éditorialiste de La France Agricole (30 mars 1961) : « Même dans les milieux agricoles, il s’est trouvé des gens assez compromis pour accepter sans protester, voire soutenir l’accélération de cette érosion humaine qui dépeuplait ce désert français. »