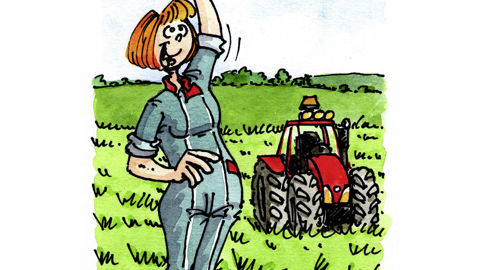L’histoire. La culture du champignon exige des méthodes de culture spécifiques et un savoir-faire bien particulier. Cela ne faisait pas peur à Pierre, qui avait décidé de prendre à bail des caves destinées à la culture des champignons de couche. Lors de son installation, il avait signé avec les bailleurs une convention portant sur la cession à titre onéreux des « méthodes de culture, procédés et savoir faire de l’exploitation. »
Après des années de labeur, le preneur a reçu un congé fondé sur l’âge de la retraite. Si cette cause objective de départ était incontestable, pour autant, le preneur s’est rappelé qu’il avait payé un pas-de-porte bien trop cher lors de son entrée dans les lieux, qu’il pouvait espérer récupérer.
Le contentieux . Aussi, Pierre a-t-il saisi le tribunal paritaire et sollicité sur le fondement de l’article L 411-74 du code rural, la restitution par les bailleurs des sommes qu’il estimait avoir trop payées en vertu de la convention conclue lors de son entrée dans les lieux. Il estimait qu’elles portaient sur la cession des éléments de l’exploitation, qui n’étaient ni cessibles ni valorisables, et déguisaient le versement de ce que l’on appelle un « chapeau » prohibé. Il est vrai que le statut du fermage réprime les pratiques consistant à monnayer, directement ou indirectement, le bail rural à l’occasion d’un changement d’exploitant : l’infraction consiste à « faire payer le bail » par le preneur entrant, à la demande du bailleur ou du fermier sortant. Aussi, persuadé par son avocat qu’il avait raison, puisque dans le passé la Cour de cassation avait déjà sanctionné des cessions d’éléments d’actifs qui dissimulaient une cession de bail, Pierre n’avait pas vraiment été surpris de la réponse apportée par la cour d’appel. Celle-ci avait accueilli la demande de restitution, en retenant que les méthodes de culture, procédés et savoir-faire, à supposer qu’ils fussent propres au cédant et que leur connaissance ne fût pas directement accessible au public, ne pouvaient constituer des éléments cessibles de l’exploitation agricole. Il fallait donc restituer au preneur entrant les sommes trop versées trente années auparavant avec les intérêts.
Saisie par le bailleur, la Cour de cassation s’est montrée plus ouverte : elle a censuré les juges d’appel en leur reprochant de ne pas avoir recherché en quoi les méthodes de culture ou le savoir-faire ne pouvaient constituer des éléments cessibles de l’exploitation agricole lors d’un changement d’exploitant. Il est vrai que, en 2009, la haute juridiction avait jugé que des éléments incorporels, tels le droit de présentation d’une clientèle professionnelle autre que commerciale et une clause de non-concurrence étaient des droits cessibles.
L’épilogue. La solution retenue permet d’appréhender les éléments constitutifs du fonds agricole, dont la loi du 5 janvier 2006 d’orientation agricole a dessiné les contours, et à faire entrer de plain-pied l’exploitation agricole dans la réalité économique en lui reconnaissant un véritable statut d’entreprise.