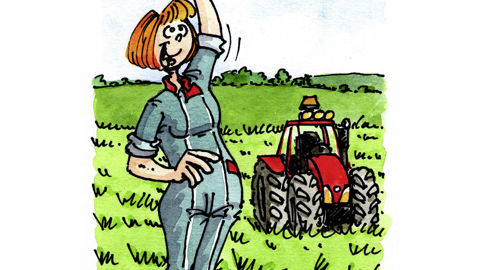L’histoire. Ida était propriétaire d’un tènement de terrains limitrophes d’une parcelle conduisant à la route. Elle n’était pas dans les meilleurs rapports avec sa voisine, Marguerite. Toute discussion à l’amiable étant inutile, elle a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance pour voir reconnaître l’existence d’une servitude conventionnelle de passage au profit de son fonds. Ida soutenait que lorsque Marguerite avait acheté son terrain, il était mentionné dans l’acte d’acquisition que la parcelle acquise était tenue de plusieurs servitudes au profit de son voisin.
Le contentieux. Devant le tribunal, Marguerite a contesté tout le raisonnement de son adversaire. Il est évident que, juridiquement, elle ne voyait pas d’un bon œil la prétention et s’y opposait. La question est classique devant les tribunaux de grande instance : Ida, demanderesse à la servitude, se qualifiait de fonds dominant, le fonds qui devait supporter la servitude constituant le fonds servant. Mais attention, dans son article 682, le code civil accorde un droit de passage sur le fonds d’autrui si celui-ci n’a pas d’issue sur la voie publique. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce, car Ida avait accès à la route. L’affaire soumise au tribunal constituait le contentieux d’une servitude conventionnelle. Ida ne remplissait pas du tout les conditions de l’article 682 du code civil et il s’en déduisait qu’elle devrait exciper et déposer entre les mains du tribunal un acte notarié prouvant que Marguerite ou son vendeur avait consenti le droit de passage au profit de son fonds. C’est ici que s’articule le point crucial de la discussion : dans l’acte d’acquisition, il était simplement déclaré que le bien acquis était redevable de plusieurs servitudes et notamment l’une au profit du fonds voisin. C’est ce que l’on appelle un acte récognitif d’une servitude qui existerait, mais qui n’est pas prouvée. Il ne s’agissait pas d’un acte créatif de servitude. Il n’empêche que la cour d’appel avait jugé qu’Ida bénéficiait d’une servitude de passage sur le fonds, mais la seule mention de celle-ci dans l’acte d’achat suffisait-elle ? Non, dira la Cour de cassation : l’acquéreur, Marguerite, aurait dû être informée par acte notarié d’une servitude de passage au profit d’Ida.
L’épilogue. Certes, la cour d’appel a été censurée. Mais la cassation n’emporte pas solution. C’est la cour de renvoi qui devra répondre à la demande d’Ida. Elle devra lui intimer de produire un acte notarié créant à son profit une servitude de passage. La jurisprudence a déjà eu à statuer sur le cas où le fonds servant n’est pas mentionné dans l’acte d’acquisition. La décision ainsi rendue a une incidence certaine, car elle condamne l’absence de preuve de l’acte simplement récognitif.