Installé depuis 2019, Benoît Jacquot a repris une exploitation bio de la plaine alluviale du Val d’amour à Bans, près de Dole dans le Jura. « Pour moi, le bio n’est pas une option, souligne l’ancien cadre de l’industrie puis technicien de chambre d’agriculture dans le Jura. C’est le système qui me ressemble le plus et qui répond à mes objectifs de santé (la mienne et celle des autres), d’environnement, d’autonomie économique et décisionnelle. La conjoncture difficile ne remet pas en cause ce choix. »
Des adaptations permanentes
Différents leviers sont actionnés pour atteindre les objectifs que Benoît Jacquot s’est fixé : diversification des cultures, couverts végétaux en intercultures, restitution au sol de 100 % des pailles, mélanges variétaux des céréales, semis tardif pour mieux gérer les mauvaises herbes. Une pratique qui s’est avérée difficile cette année compte tenu des fortes pluies. Au 25 novembre, seulement la moitié des 25 hectares étaient semés. « On s’adaptera en faisant du blé de printemps », pointe Benoît.
L’assolement est adapté aux différents types de sol : luzerne, blé, soja et tournesol dans les terres argileuses à bon potentiel (60 % de la surface), blé « anciens », seigle, épeautre (grand et petit), sarrasin, soja, tournesol et prairie temporaire (trèfle) dans les limons battants.
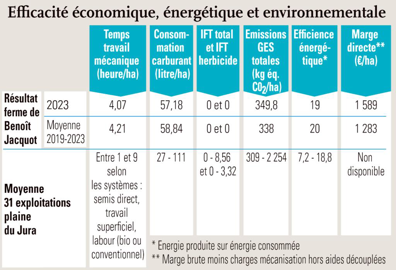
100 % des pailles restituées
Les rotations démarrent par quatre ans de prairies temporaires, suivies par deux cultures d’hiver, puis deux de printemps. Alors que les coupes de fourrages du milieu sont vendues sur pied à des éleveurs en zone Comté AOP, les premières et dernières sont fauchées et laissées au sol pour enrichir ce dernier.
Les pailles sont restituées à 100 %. Outre l’apport de carbone, c’est une économie de mécanisation. La première année de son installation, Benoît avait pratiqué l’échange paille-fumier mais il a arrêté compte tenu du bilan carbone négatif.
Les couverts végétaux en interculture sont testés et utilisés depuis la reprise de l’exploitation, conduite en bio depuis 1998. Une évidence pour l’agriculteur : « Laisser un sol sans couvert est une hérésie. » Traditionnellement semés après la récolte des céréales, ils sont désormais implantés en terres argileuses dans les céréales en sortie d’hiver.
« Semer le plus tôt possible au “cul” de la moissonneuse-batteuse s’avère difficile, non seulement à cause des sécheresses et des pailles hautes de nos céréales anciennes non exportées, mais aussi de notre emploi du temps. Deux ou trois jours après la récolte, nous trions nos céréales avant de les stocker. »
Des luzernes implantées sous le tournesol
Du trèfle violet est implanté avec un semoir sur une herse étrille, à la fin de mars à raison de 14 kg/ha. La céréale est semée un peu plus épaisse pour compenser les pertes éventuelles de plantes (10 %). Le trèfle est fauché deux ou trois fois avant son enfouissement au printemps suivant. « On ne laisse pas le trèfle pousser trop longtemps, précise Benoît. On le fauche assez vite, ce qui favorise la repousse. » Avant d’opter pour le trèfle violet, l’agriculteur avait essayé le trèfle d’Alexandrie, qui pousse vite mais souffre de l’ombre du blé, ainsi que le trèfle incarnat.

Les luzernes sont également implantées dans une culture en place (le tournesol en l’occurrence), au 15-20 avril avec le semoir sur la herse étrille. « Lors des étés chauds et secs, on se fait parfois des frayeurs, note l’agriculteur. On a l’impression que la luzerne disparaît. Mais non : dès que le tournesol a été récolté, la légumineuse repart. »
Le suivi de parcelles avec pesées, réalisé dans le cadre du GIEE Bioforce, montre que ces semis des couverts ne pénalisent pas les rendements de la culture en place.
Dans les terres limoneuses qui gardent mieux l’humidité, les couverts à base de semences de ferme de triticale, de pois, de seigle, sont implantés dès la récolte. Selon les années, les résultats sont plus aléatoires.







