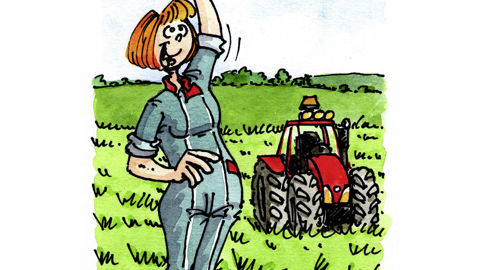L’HISTOIRE. Pour Pierre, les vendanges de son domaine en appellation « Ventoux » se présentaient bien. Encore quelques semaines de soleil et la machine à vendanger pourrait passer. Pourtant, quelle déception, lorsqu’un matin, il avait constaté que les vignes avaient été ravagées par des hordes de sangliers, qui s’étaient régalés de ses raisins ! Pierre, qui vinifiait lui-même sa récolte, avait demandé à la fédération des chasseurs du Vaucluse la réparation de son préjudice résultant de la perte du vin que les 3 383 kg de raisin auraient produit, calculé à la bouteille. Mais la fédération ne s’était pas montrée généreuse : elle avait proposé une indemnisation limitée à la seule perte du raisin.
LE CONTENTIEUX. Pierre, qui ne pouvait accepter une telle proposition, avait assigné la fédération devant le tribunal en réparation de l’intégralité de son préjudice résultant de la perte de sa récolte. Pour lui, celle-ci devait couvrir la perte subie du raisin et celle du gain manqué du fait de l’impossibilité de produire et de commercialiser le vin correspondant. Il avait invoqué l’article L. 426-1 du code de l’environnement qui prévoit qu’« en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles par les sangliers, provenant d’une réserve où ils font l’objet de reprise ou d’un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l’indemnisation à la fédération départementale des chasseurs ». Pierre avait bien droit à être indemnisé de l’intégralité de son préjudice, résultant de la perte de sa récolte couvrant la perte subie du raisin et le gain manqué par la perte de chiffre d’affaires. En effet, pourquoi réduire la perte agricole visée à l’article L. 426-1 à la seule perte des produits bruts ?
Pourtant, selon la fédération des chasseurs, il n’y avait pas de discussion possible. Ce texte ne pose en effet une responsabilité sans faute de la fédération départementale qu’aux fins d’assurer l’indemnisation de la « perte de récolte », et nullement l’indemnisation de l’entier préjudice de l’exploitant agricole, laquelle peut toujours être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil (1). Les juges lui ont donné raison : la perte de récolte devait s’entendre de la perte des produits effectivement récoltés et non des produits transformés issus de la récolte ; aussi le préjudice de Pierre était seulement constitué de la perte des raisins et non de la perte de commercialisation future par celui-ci du vin en bouteilles obtenu à partir de ces raisins.
L’ÉPILOGUE. Pierre aurait-il pu obtenir une meilleure indemnisation en se fondant sur les dispositions générales de l’article 1382 du code civil ? Rien n’est moins sûr, car la Cour de cassation a, depuis longtemps, retenu une interprétation très réductrice de la notion de « perte de récolte ». Alors Pierre devra, comme ses voisins, entourer ses vignes de clôtures électriques, en s’interrogeant pourtant sur leur efficacité qui est loin d’être parfaite, face à la force tranquille des prédateurs…
(1) Cour de cassation, 14 juin 2007, n° 06-16952.