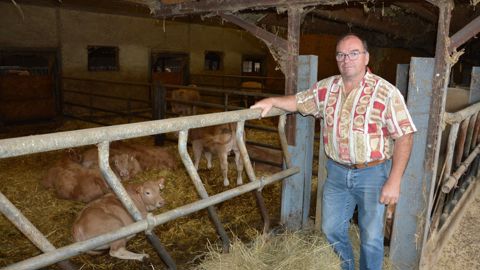Les premiers résultats de l’étude MetaPDO Cheese conduite par l’Inrae ont de quoi mettre du baume au cœur aux producteurs de lait et de fromages d’appellation d’origine protégée. « Nous avons pu mettre en évidence que le facteur « AOP » influence significativement la composition microbienne des laits et des fromages. La structuration des écosystèmes microbiens fromagers débute dès la production du lait à la ferme en lien avec les pratiques des éleveurs et les différents cahiers des charges, explique Céline Delbes, directrice de recherche à l’Inrae d’Aurillac (Cantal). Cette diversité microbienne est importante pour l’expression des qualités organoleptiques des fromages d’appellation, leur goût, leurs arômes et l’aspect de la croûte. Elle contribue à une alimentation diversifiée dont on sait aujourd’hui l’impact positif sur la santé humaine. »
Métagénomique
Alors que les levains commerciaux d’acidification et d’affinage sont bien identifiés, les communautés microbiennes « locales » construites par les pratiques (animal, alimentation, saumure, matériel et locaux…) sont moins connues. Elles ont été le sujet de l’étude MetaPDO Cheese conduite en lien avec le Réseau Fromages de Terroirs et les filières AOP. Dix échantillons de lait et de fromages pour chacune des 44 AOP ont été « auscultés » par des méthodes métagénomiques (1). L’objectif ? Couvrir la diversité des pratiques et des conditions géographiques (altitude, sol) et climatiques. L’analyse du microbiote de 1 200 fromages (cœur et surface) dénombre 820 espèces microbiennes et 333 espèces fongiques. Celle de 370 laits a, quant à elle, révélé 1 230 espèces bactériennes et 1 367 espèces fongiques.
Ce projet favorise une meilleure connaissance de la flore des fromages AOP et une appropriation des méthodes métagénomiques. À moyen terme, les équipes de recherche souhaitent comprendre les mécanismes d’adaptation des souches endogènes au contexte fromager et plus largement, la manière dont se structurent les écosystèmes microbiens.
Plusieurs filières projettent d’ores et déjà d’isoler et de sauvegarder les ferments « autochtones » afin de préserver la typicité de leur production. Le maintien de cette biodiversité tient aussi à une amélioration permanente des pratiques d’élevage et de fabrication.
(1) Méthode d’étude du contenu génétique d’échantillons issus d’environnements prélevés dans la nature par opposition à des échantillons cultivés en laboratoire.