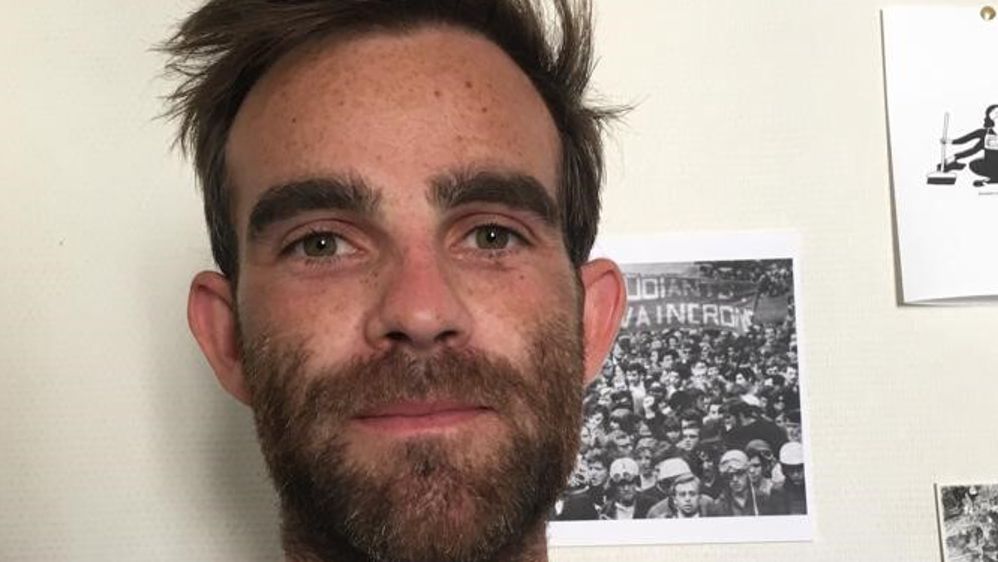Depuis quand la question de l’exposition des riverains aux produits phytos connaît une visibilité croissante ?
« La montée en puissance de la question de l’exposition des riverains aux pesticides depuis une dizaine d’années dans l’espace public semble liée à l’actualité juridique (lois, actions en justice), médiatique (reportages, documentaires, livres), politique (institutionnalisation de l’agroécologie), scientifique (études épidémiologiques, outils de mesure de l’exposition), citoyenne et associative (collectifs de riverains, associations type Générations Futures). »
Quels sont les facteurs déclenchants ?
« Ils sont multiples, on peut citer :
- La visibilité tardive de l’impact des produits phytos sur la santé des travailleurs ;
- La montée des thématiques sanitaires et environnementales depuis les années quatre-vingt. Les pressions environnementales deviennent petit à petit un objet de préoccupation avec la prise en compte des externalités négatives des activités productives (industrielles et agricoles) et des scandales sanitaires environnementaux ;
- Les mobilisations contre l’utilisation des pesticides mouvements citoyens et associatifs, qui émergent depuis une dizaine d’année ;
- La recomposition de l’espace rural et l’évolution sociologique de l’occupation des sols. La rurbanisation (l’étalement urbain et la déconcentration des populations urbaines) accroît la visibilité du travail agricole en rapprochant les espaces de vie des espaces productifs. La montée en puissance de la fonction du cadre de vie résidentiel, récréatif et esthétique peut accentuer les sources de tensions entre personnes qui ont des usages différents du territoire. »
Comment réduire les tensions entre agriculteurs et riverains quand il y en a ?
« Les produits phytosanitaires ne sont pas qu’une nouvelle forme de conflit de voisinage et cette problématique ne peut être isolée des enjeux sanitaires environnementaux, scientifiques, démographiques, etc. qui participent de son émergence comme problème public. La question des « bonnes pratiques » et de l’évolution des pratiques agricoles n’est pas que de l’affaire des agriculteurs et riverains, mais aussi des opérateurs du secteur agricole, agroalimentaire et des acteurs politico-administratifs. Focaliser l’attention sur les agriculteurs et riverains contribue à détourner le regard sur les limites du modèle agricole ayant recours de manière intensive aux pesticides auxquels les agriculteurs sont attachés par une série de dépendances (techniques, agronomiques, économiques et professionnelles). »
Vous êtes coauteur du film documentaire « Terrain d’entente » montrant les efforts réalisés pour se comprendre et cohabiter sur un territoire à la fois agricole et résidentiel. Quels sont les retours sur ce film ?
À ce jour, le documentaire a été projeté dans une dizaine de collectivités et plusieurs territoires. L’expérience du film permet aux spectateurs de dépasser les jugements tranchés et les clivages souvent fondés sur une vision réductrice de l’autre et des situations, pour faire comprendre les points de vue de chacun. Le film devient finalement un espace de dialogue, de rencontre et d’écoute qui permet de restaurer un temps utile à la réciprocité.
(1) Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle dans le Vaucluse. Étienne Amiet est coauteur du film documentaire « Terrain d’entente » montrant les efforts réalisés pour se comprendre et cohabiter sur un territoire à la fois agricole et résidentiel. Il a publié en 2018 aux Éditions La Discussion « La riveraineté à l’épreuve des pesticides » à la suite d'une enquête dans le Beaujolais.