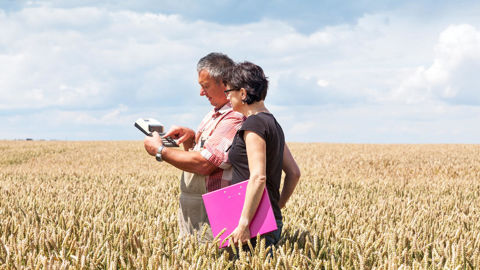« Nous ne sommes plus du tout sur des stratégies de traitements systématiques mais bien dans un véritable raisonnement de la protection », constate Arvalis. Avec un impact des maladies estimé à 18 q/ha en 2015 (17 q/ha pour la moyenne pluriannuelle), les agriculteurs ont su adapter leurs dépenses fongicides sur blé tendre puisqu’il a diminué de 5 €/ha.
Toutefois, dans le contexte Ecophyto 2, ce raisonnement de la protection devra assurément être renforcé.
Le premier levier d’action reste sans conteste le choix variétal (voir le tableau ci-dessous). Dans bien des cas, comme sur piétin verse, cela peut s’avérer plus efficace qu’un traitement.
Sur blé, les fongicides représentent le poste de dépense le plus important en matière de produits phytosanitaires. Il est possible de le réduire en exploitant au mieux les résistances variétales. Et si la variété résistante à tout n’existe pas, il s’agira de cibler les maladies les plus présentes dans le contexte pédoclimatique de chacun. A titre d’exemple, au Nord-Ouest, et notamment en bordure maritime, le risque rouille jaune est souvent plus élevé. Pour la rouille brune, c’est la moitié sud qui est plus fréquemment touchée. « Le choix d’une variété peu sensible, à 15 q/ha de nuisibilité, économise près de 30 euros de charges de fongicides par rapport à une variété sensible, à 25 q/ha de nuisibilité moyenne », ajoute l’institut.
Pourtant, la résistance n’est pas encore la principale entrée dans le choix variétal. Ce sont plutôt le rendement et le débouché, donc le revenu, qui sont regardés en premier lieu. En outre, les producteurs spécialisés dans les grandes cultures cultiveraient en moyenne quatre variétés de blé tendre et les trois quarts des surfaces recevraient le même programme fongicide alors que le programme de traitement devrait être adapté à la variété. « Lorsque les CEPP (Certificats d’économies de produits phytosanitaires) (1) seront en place, peut-être que ce critère sera pris en compte », estime Jean-Yves Maufras, ingénieur au pôle maladies et méthodes de lutte chez Arvalis.
Lutte agronomique
L’utilité des bonnes pratiques prophylactiques, qui visent à prévenir l’apparition ou la propagation d’une maladie, n’est pas toujours perçue par l’agriculteur et elles sont parfois oubliées, voire négligées, au profit d’une lutte chimique à laquelle une grande confiance est accordée », souligne encore l’institut.
Pourtant, la gestion des résidus de culture du précédent ainsi qu’une rotation sans précédents sensibles (maïs et sorgho) sont des points clés pour lutter contre la fusariose, par exemple. En effet, Fusarium graminearum, producteur de la mycotoxine Don sur blé, passe l’hiver dans les résidus de culture.
Les blés sur blés, les rotations courtes, les dates d’implantation précoces, les fortes densités ainsi que les doses d’azote élevées sont autant de facteurs qui favorisent le piétin verse et sur lesquels on peut agir.
Utilisation des outils d’aide à la décision
Les traitements peuvent par ailleurs être raisonnés en s’aidant d’outils d’aide à la décision comme Atlas maladies du blé, qui s’appuie notamment sur le modèle Septo-Lis d’Arvalis (et sur d’autres modèles rouilles brune et jaune). Il tient compte de la sensibilité variétale, de la date de semis, de l’évolution physiologique de la culture et des prévisions météorologiques. Avec un nombre d’hectares suivis significatifs cet outil de pilotage a eu toute son utilité dans le contexte de l’année. Il a permis de retarder le déclenchement du T1 et d’intervenir à temps avec le T2 pour une bonne protection de la F1.
Côté adjuvant, l’institut, qui conseille souvent d’employer des moitiés de doses homologuées, ne pousse pas à leur utilisation. « Ça n’a pas forcément d’intérêt dans ce cas de figure. En revanche, quand il y a quatre à cinq traitements à petites doses, cela peut apporter de l’efficacité. Mais c’est très technique ! », prévient le spécialiste.
Sur le fractionnement à doses réduites (lire le témoignage page 53), Arvalis estime que cela peut accentuer la sélection de souches résistantes. Les agriculteurs utilisent souvent plusieurs fois les mêmes matières actives à 10 ou 15 % de la dose homologuée. En agissant ainsi, ils ne suivent pas toujours la réglementation, ni même avec les recommandations de la note commune. « Dans les stratégies de microdoses, il est nécessaire de diversifier les molécules », appuie Jean-Yves Maufras.
Frémissement du biocontrôle
Et le biocontrôle ? « C’est vrai qu’on en parle beaucoup plus qu’il n’y a de solutions sur le marché en grandes cultures ! », souligne Claude Maumené, en charge de ce dossier chez Arvalis. Il faut rappeler que si la recherche est active sur ce sujet, il y a peu de produits de biocontrôle qui aident à lutter contre les pathogènes des céréales à paille.
En végétation, seul est disponible depuis plusieurs années Vacciplant GC, à base d’algue (laminarine). D’ailleurs depuis deux ans, Goëmar a modifié le positionnement de sa spécialité. Désormais, elle est proposée au T1 en association avec un fongicide à dose réduite (- 40 à - 50 %). Malgré tout, dans les essais d’Arvalis (réalisés sur plusieurs années), il ressort invariablement que « l’apport de Vacciplant GC ne permet pas de compenser les quintaux perdus imputables à la réduction de dose du T1 ».
« On peut espérer voir arriver d’ici quelques années des produits qui se suffiront à eux-mêmes, estime Claude Maumené. Pour cela, il faut une bonne appropriation de la distribution. » C’est pourquoi l’institut est à l’initiative de la création d’un réseau d’excellence expérimental (R2E), en collaboration avec sept coopératives ayant l’agrément BPE (bonnes pratiques d’expérimentation). Lancé depuis un an, leurs travaux ont commencé par l’évaluation de solutions de biocontrôle.
En parallèle, l’arrivée d’un nouveau produit de biocontrôle sur ce créneau est annoncée. Preuve que le gouvernement mise sur ce type de produit pour se substituer aux classiques produits phytosanitaires !
De Sangosse vient, en effet, d’obtenir par reconnaissance mutuelle (République tchèque) l’homologation de Polyversum. Il s’agit d’un champignon actif sur la fusariose du blé qui pourra être associé à un fongicide conventionnel. « Il ne sera pas commercialisé en 2016 afin de réaliser des expérimentations et de caler les préconisations techniques », explique François Benne, chef du marché grandes cultures chez De Sangosse.
Quant à Dow AgroSciences, il annonce l’arrivée en 2018 d’Inatreq Active, un fongicide d’origine naturelle qui aurait une action sur septoriose et rouilles.
(1) Dispositif qui vise à inciter les distributeurs de produits phytosanitaires à promouvoir ou à mettre en œuvre auprès des utilisateurs professionnels des actions permettant de réduire l’utilisation, les risques et les impacts phytos.