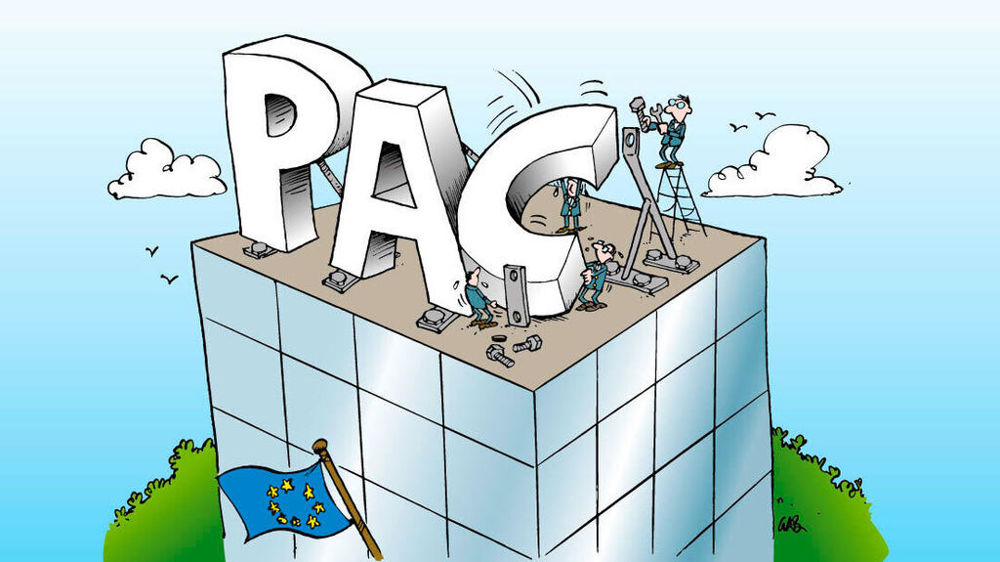La Pac a déjà subi de nombreuses réformes au cours de son histoire, mais cette nouvelle mouture pourrait être classée au rang des révolutions. Historiquement centralisées à Bruxelles et appliquée à toute l’Union européenne, les États membres ont cette fois pu choisir comment ils allaient appliquer leurs grandes stratégies pour l’agriculture. Lancée en 2017, cette réforme a vu chaque gouvernement soumettre ses orientations via des plans stratégiques nationaux (PSN), évalués et validés par la Commission européenne au cours de l’année 2022. En place depuis le 1er janvier 2023, cette formule aura jusqu’en 2027 pour faire ses preuves.
Si ce nouveau fonctionnement n’a pas éclipsé la tutelle de l’Union européenne, chaque membre a récupéré des marges de manœuvre jamais vues jusqu’alors. Avec désormais 28 plans stratégiques nationaux en vigueur, les différences de stratégie et d’ambition au sein de l’Union apparaissent au grand jour.
28 nuances de vert
Propulsé sur la scène européenne en 2019, le pacte vert ou « green deal » a largement influencé la construction de cette nouvelle Pac et des différents PSN. C’est notamment visible dans les tout nouveaux outils mis à la disposition des États depuis cette réforme : les écorégimes. Imaginés pour accélérer la transition agroécologique, ils sont intégrés au premier pilier de la Pac et sont censés encourager les agriculteurs vers des démarches positives pour l’environnement, le bien-être animal ou le climat.

Si les écorégimes sont facultatifs pour les agriculteurs, ils doivent toutefois représenter un niveau de dépense au minimum de 25 % de l’enveloppe du premier pilier pour chaque État membre. Et ce sont ces mêmes États membres qui déterminent les pratiques et critères qui permettront aux agriculteurs d’accéder à ces aides. Pour Marine Raffray, de Chambre d'agriculture France, ce fonctionnement a eu des conséquences. « Sachant que les États membres avaient cette obligation d’un niveau minimal de dépenses, il fallait qu’ils réfléchissent à un bon équilibre. D’une part, avoir des mesures qui rentrent dans les objectifs du pacte vert, mais d’un autre côté qui ne soit pas trop ambitieuse, faute de quoi ils n’atteindront pas les 25 %. Et en 2025, ils risquent de se faire sanctionner », explique-t-elle. Le choix des critères pour accéder à ces écorégimes entraîne toutefois des conséquences inattendues. En Allemagne par exemple (voir l'encadré), le pays déplore une faible adhésion des agriculteurs, à cause de critères trop restrictifs dans les écorégimes, faisant craindre pour l’utilisation du budget.
Épluchés par la Commission européenne dans un rapport, les 158 écorégimes recensés dans les PSN, ne logent pas toutes les thématiques à la même enseigne. Les pratiques de conservation des sols sont par exemple incluses dans les écorégimes de tous les pays membres, tout comme les mesures pour atténuer les changements climatiques où seule la République de Malte a fait l’impasse. En revanche, les écorégimes concernant le bien-être animal ont été boudés dans 17 PSN sur 28. Sur les pesticides, 7 PSN, dont ceux de l’Espagne, de l’Irlande ou de l’Autriche, n’ont pas inclus d’écorégimes les concernant.
Une conditionnalité plus adaptée
Des différences apparaissent aussi sur la conditionnalité. Là aussi, les États membres ont obtenu quelques latitudes pour l’application des BCAE (bonnes conditions agricoles et environnementales). Pour la BCAE 5 visant à prévenir de l’érosion par exemple, les critères d’application pour définir les zones à risques (inclinaison…) ont été laissés à la discrétion des États, tout comme les mesures obligatoires à mettre en œuvre (interdiction de cultiver, orientation du labour…).
C’est plus visible encore pour la BCAE 6 sur la couverture minimale des sols. Chaque pays membre pouvant désormais prendre des mesures réellement adaptées au contexte local. C’est ainsi qu’on peut voir une grande partie des plans stratégiques nationaux exiger une couverture des terres au minimum à 80 %, voire 100 % de l’année (France, Allemagne, Italie…), mais aussi certains ne placer la barre qu’à 55 % (Lettonie) ou 33 % (Finlande), voire des taux graduels selon les régions comme en Suède (30 à 70 %).

Des objectifs plus ou moins ambitieux
Mais pour voir les grands écarts européens, il faut chercher du côté des valeurs d’objectifs fixées par les États membres sur certains indicateurs de résultats. Dans ce domaine, la réduction des émissions de gaz à effet de serre en élevage est un exemple éloquent. Quand la Finlande a choisi de se fixer une réduction de 46,5 % ou la Lettonie à 29,3 %, la plupart des grands pays agricoles européens (France, Allemagne, Pologne…) n’ont fixé aucun objectif dans leurs PSN.
Autre exemple sur le stockage du carbone dans le sol, la Finlande encore, prévoit de soumettre 77 % de sa surface à des mesures favorables tandis que les Pays-Bas fixent cet objectif à 64,2 %. De l’autre côté du spectre se trouve l’Irlande avec seulement 8,9 %. Pour l’utilisation réduite et durable des pesticides, on retrouve aussi des disparités. La Croatie et la Flandre se sont fixées des objectifs de 12,6 % et 13,5 % respectivement de leur SAU à l'horizon de 2028 quand l’Autriche est à 44 % mais surtout la France à 61,1 % de sa SAU.
Ces engagements pris par les États membres restent toutefois à relativiser car les objectifs sont rattachés à une situation de base qui n’est souvent pas précise, comme l’observe Marine Raffray. « Pour la baisse des produits phytosanitaires, l’indicateur de résultat, c’est le pourcentage de la SAU qui reçoit des aides à la baisse de l’utilisation des produits phytosanitaires. Comment va-t-on mesurer la baisse effective de l’utilisation des produits phytosanitaires ? Pour l’instant, je n’ai pas vu la méthodologie que va employer la Commission européenne pour faire ce lien » observe-t-elle.
Des interrogations pour la suite
L’évaluation, c’est pourtant ce qui fera office de juge de paix dans les prochaines années. En 2025, la Commission européenne opérera un bilan de chaque plan stratégique national appelé « revue de performance ». À la suite de ces bilans, des recommandations, voire des sanctions pourront être infligées aux États membres. La même procédure prendra place également à la fin de la période de cette Pac en 2027. Quant au barème d’évaluation et les sanctions envisagées, difficile pour l’instant d’y voir clair.