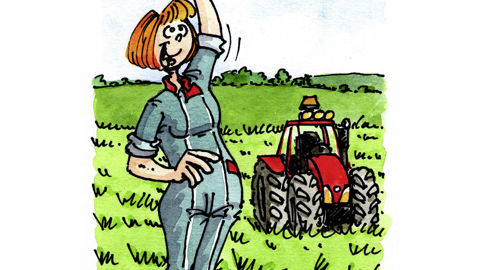L’HISTOIRE
Il faut se méfier des idées toutes faites et veiller à l’évolution de la jurisprudence. Irène en a fait l’expérience. Durant de nombreuses années, elle avait exploité avec Basile, son mari, un joli mas entouré de parcelles, dont ils avaient fait l’acquisition peu de temps après leur mariage. Mais l’unité conjugale s’étant délitée, le divorce avait été prononcé. Irène avait alors conservé la jouissance du mas. Et Basile, qui avait trouvé un appartement dans le village voisin, avait poursuivi la mise en valeur des parcelles. Lors de la liquidation de la communauté, Irène avait demandé à son ex-époux de lui verser le montant de sa quote-part des taxes d’habitation acquittées par ses soins durant son occupation privative du mas.
LE CONTENTIEUX
Devant le refus opposé par Basile, Irène l’avait assigné devant le tribunal judiciaire en remboursement de sa quote-part de la taxe d’habitation qu’elle estimait avoir payé pour son compte. Elle considérait, en effet, qu’il s’agissait d’une charge, relative à la conservation du bien, que doivent régler tous les indivisaires.
Il était traditionnellement acquis que la taxe d’habitation et les charges de copropriété courantes correspondant à l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif, relevaient des frais liés à l’occupation privative de l’indivisaire et incombait en totalité à l’occupant. Pour Basile, il n’y avait donc aucune discussion possible. Puisqu’Irène avait conservé, à la suite du divorce, la jouissance privative du mas familial demeuré dans l’indivision, le paiement de la taxe d’habitation lui incombait en totalité.
Les juges lui avaient donné raison. Ils avaient retenu qu’aucune somme ne pouvait être réclamée à l’indivision par son ex-femme, la taxe d’habitation incombant à l’occupant de l’immeuble.
Irène, qui avait consulté un avocat à la Cour de cassation, avait eu connaissance d’un revirement de jurisprudence intervenu en 2018. Par un arrêt remarqué, la haute juridiction s’était appuyée sur l’article 815-13, alinéa 1, du code civil, qui prévoit l’indemnisation de l’indivisaire ayant fait, sur ses deniers personnels, des dépenses nécessaires pour la conservation des biens indivis. Aussi, avait-elle estimé que la taxe d’habitation avait permis la conservation de l’immeuble indivis et qu’elle devait être supportée par les coïndivisaires, proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. À la suite du pourvoi formé par Irène, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel.
L’ÉPILOGUE
Dans la mesure où le règlement de la taxe d’habitation avait permis la conservation de l’immeuble indivis, la cour de renvoi devra en tirer les conséquences, en imputant à Basile le paiement de la moitié des sommes payées par Irène durant les années d’occupation privative du mas familial.
Il faut donc abandonner l’idée bien ancrée : désormais, ce n’est plus à celui qui « habite » dans l’immeuble indivis qu’incombe la charge du règlement de la taxe d’habitation, mais bien à l’ensemble des indivisaires.