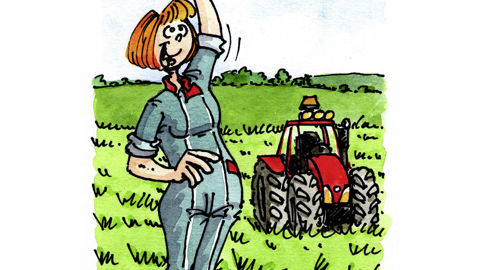L’histoire
En 1985, Jean-Louis avait pris la suite de ses parents sur l’exploitation familiale. Il avait repris le bail à ferme portant sur des terres appartenant à Marie, et mises à la disposition du Gaec du Bel é pi, qu’il avait constitué avec son frère. à l’occasion de la transmission de l’exploitation et du bail, Jean-Louis avait apporté, au capital du Gaec, la créance d’améliorations réalisées sur les terres louées, transmise par ses parents, moyennant l’attribution de parts sociales. Les années avaient passé et le bail avait été renouvelé. Désirant prendre sa retraite, Jean-Louis avait sollicité de Marie l’autorisation de céder le bail à son fils. Une demande que sa propriétaire lui a refusée.
Le contentieux
Aussi, Jean-Louis avait-il saisi le tribunal paritaire en vue d’être autorisé à céder son bail. Après tout, Marie ne pouvait lui refuser cette faculté expressément prévue par le statut du fermage. Il avait toujours rempli ses obligations, en payant régulièrement le fermage, en entretenant correctement les biens loués et en informant Marie de leur mise à disposition au profit du Gaec. De plus, celle-ci ne pouvait ignorer que le fils du preneur remplissait toutes les conditions pour poursuivre la mise en valeur des parcelles. Elle savait qu’il justifiait d’un vrai projet économique et d’une autorisation d’exploiter. Enfin, le bail avait été renouvelé à deux reprises, sans aucune difficulté.
Mais devant le tribunal, l’avocat de Marie avait invoqué l’article L. 323-14 du code rural. Selon ce texte, la mise à disposition des biens loués au profit d’un Gaec, dont le preneur est associé, ne donne pas lieu à l’attribution de parts à ce dernier, qui reste seul titulaire du bail. La jurisprudence lui était également favorable. La Cour de cassation avait déjà considéré que l’amélioration du fonds s’incorporant à l’immeuble ne saurait faire l’objet d’un apport en société par le preneur. Aussi, en apportant au capital du Gaec la créance d’améliorations détenue sur Marie, Jean-Louis s’était livré à une opération à titre onéreux illégale, de nature à le rendre de mauvaise foi.
Mais l’argument était-il véritablement pertinent ? La loi du 1er février 1995, applicable aux baux en cours, n’avait-elle pas autorisé le preneur à céder à la société les améliorations faites sur le fonds mis à sa disposition ? Or, le bail de Jean-Louis avait bien été renouvelé en 1997, après l’intervention de la loi, de sorte que l’opération était couverte. Mais les juges n’ont pas été convaincus par ce discours. La faculté de cession est réservée au preneur qui s’est constamment acquitté de ses obligations. Cependant, l’apport effectué par Jean-Louis en 1985 ne pouvait être rétroactivement régularisé par la loi du 1er février 1995, qui avait assoupli le dispositif de cession des améliorations par le preneur sortant. Aussi, ayant porté atteinte au caractère non patrimonial du bail, Jean-Louis, preneur de mauvaise foi, ne pouvait être autorisé à le céder. Une solution que la Cour de cassation a confirmé en approuvant la cour d’appel.
L’épilogue
L’issue du recours est sévère pour Jean-Louis. Il se retrouve privé de la faculté de céder son bail, alors que l’apport au capital du Gaec de la créance d’améliorations, intervenu lors de la transmission de l’exploitation en 1985, avait été couvert par le renouvellement du bail, et validé par la loi du 1er février 1995.