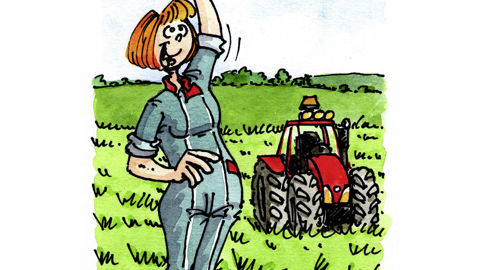L’HISTOIRE. Régis mettait en valeur, depuis de nombreuses années, un domaine agricole doté d’un cheptel composé de vaches, de paille, de foin ainsi que de betteraves. Ces biens lui étaient loués par Pierre.
Le bail avait été consenti en 1959 à ses parents avant que Régis en ait été déclaré cessionnaire par un jugement du tribunal paritaire. Au cours du bail initial, ses parents avaient abandonné l’élevage au profit de la culture de céréales et avaient vendu le cheptel. Parvenu à l’âge de la retraite, Régis avait souhaité céder le bail à son fils Maxime. Devant le refus de Pierre, il avait demandé au tribunal paritaire d’autoriser la cession.
LE CONTENTIEUX. Les juges pouvaient-ils refuser à Régis l’autorisation de céder son bail à Maxime ? On sait que la cession du bail rural au profit d’un descendant, visée à l’article L. 411-35 du code rural, ne peut bénéficier qu’au preneur de bonne foi, c’est-à-dire à celui qui s’est constamment acquitté de ses obligations. Régis pouvait-il être sanctionné du seul fait que ses parents, lors du changement de la destination de l’exploitation, avaient vendu le cheptel attaché au fonds loué ? Pouvait-il être considéré comme n’étant pas de bonne foi, et être ainsi privé de la faculté de céder son bail ?
Afin de justifier son refus, Pierre ne manquait pas d’arguments. Le cheptel était, en vertu du bail, attaché au domaine loué et constituait un immeuble par destination qui restait la propriété du bailleur et ne pouvait être cédé sans son autorisation. Aussi, peu importait qu’il eût donné son accord aux parents de Régis pour la transformation de l’exploitation d’élevage en une exploitation céréalière. Il est vrai que cet accord ne concernait pas la situation du cheptel. Pour Pierre, Régis devait alors supporter les conséquences du manquement de ses parents. En effet, les cessions successives du bail rural opèrent transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat. Ce dernier devient alors débiteur envers son bailleur des obligations qui étaient à la charge des cédants. Mais ni le tribunal, ni la cour d’appel n’ont été convaincus.
À la lecture de l’article 1826 du code civil, les juges ont considéré que c’est à la fin du bail que les comptes de cheptel se font. Le preneur doit alors laisser des animaux de chaque espèce afin de former un même fonds de bétail que celui qu’il avait reçu. Aussi, les juges ont-ils rappelé le principe selon lequel la restitution du cheptel attaché au fonds loué n’intervient qu’en fin de bail, et non pas lors de son renouvellement, ni de sa cession. Et ils ont ajouté que la vente du bétail d’origine était intervenue au temps où les parents de Régis avaient orienté leur exploitation vers les cultures céréalières.
Aucune faute ne pouvait donc être retenue à l’encontre de Régis, dont la mauvaise foi n’était pas établie. La cession devait par conséquent être autorisée, comme l’a confirmé la Cour de cassation, saisie par Pierre.
L’ÉPILOGUE. Régis pourra céder son bail à son fils Maxime. Mais lorsque le bail arrivera à son terme, ce dernier devra acquérir un cheptel de même nature et de même valeur que celui qui avait été attaché au fonds loué lors de la conclusion du bail initial.