Pour ne pas laisser les filières agricoles dans l’impasse au sujet de la protection des cultures, plusieurs dispositifs ont vu le jour ces dernières années : plan « Phosmet » contre les ravageurs du colza ; PNRI (plan national de recherche et d’innovation) contre la jaunisse de la betterave ; plan d’action sur la cerise (Drosophila suzukii), etc.
La « Stratégie Ecophyto 2030 » a aussi engagé des travaux. Dans ce cadre, la profession s’accorde pour saluer le Parsada, le Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures. Initié au printemps 2023, ce dernier a en effet bénéficié pour 2024 d’un financement « inédit » de 146 millions d’euros.
Un budget conséquent
« Sur les cultures mineures, le Parsada apporte un plus du fait de la transversalité des projets de recherche », souligne Gilles Robillard, de la Fop (Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux). De plus, auparavant, pour trouver des solutions, quelques essais pouvaient suffire, là où aujourd’hui il y a beaucoup plus de combinaisons à tester. Ces budgets permettent donc de démultiplier le nombre d’essais et d’avoir des résultats plus rapidement.
Parmi les plans d’action validés dans la première vague, beaucoup concernent la gestion des adventices (en grandes cultures et fruits et légumes notamment). Cette problématique s’est accentuée avec le retrait de molécules (s-métolachlore, trisulfuron, benfluraline…) et l’apparition de résistances. Les ravageurs sont un autre sujet important de recherche : coléoptères pour les semences et plants ; lépidoptères pour les fruits et légumes transformés… Mais si les projets déjà validés doivent normalement être financés jusqu’au bout, certaines filières s’inquiètent des coupes budgétaires prévues par le Gouvernement pour 2025 et de leur impact possible sur la suite du Parsada.
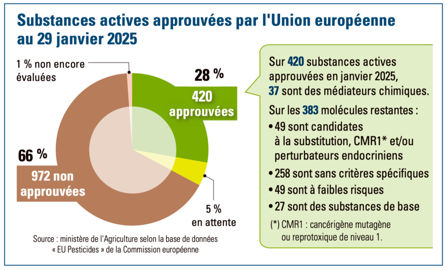
Suite au PNRI, la CGB (Confédération générale des planteurs de betteraves) constate toutefois que ce n’est pas qu’une question de budget. Malgré les 20 millions d’euros accordés pour lutter contre la jaunisse de la betterave, cinq ans plus tard, cela n’a abouti qu’à des pistes « pas opérationnelles » d’un point vu technique, et économiquement non viables pour les planteurs.
Alexis Degouy, directeur général d’Interfel (Interprofession de la filière des fruits et légumes frais), ajoute : « la réalité du Parsada, c’est que les solutions travaillées ne verront éventuellement le jour que dans quatre à cinq ans, voire plus ! » Or, il s’agit de régler les impasses immédiates que certaines filières rencontrent déjà : désherbage des endives suite au retrait du Bonalan ; punaise diabolique et balanin sur noisette depuis le retrait des néonicotinoïdes.
Comité de solutions
D’où la mise en place par le ministère de l’Agriculture du « Comité de solutions » en mars 2024. « Car le temps de la recherche est bien plus long que celui des interdictions, appuie Vincent Guillot, directeur environnement de la CGB. Par exemple, si l’on se rapporte au retrait acté depuis peu du flufénacet, avec a priori un délai de grâce de 18 mois, la promesse du « pas d’interdiction sans solution » ne sera pas tenue. »
Les premières réunions du Comité de solutions, prometteuses, ont permis de recenser les solutions de protection disponibles au sein des autres États membres. La DGAL (Direction générale de l’alimentation) indiquait par exemple en mars dernier qu’en légumes « environ la moitié des solutions identifiées pourraient couvrir les usages en difficulté ». Mais pour cela, il faut passer par le système de reconnaissance mutuelle d’AMM (Autorisation de mise sur le marché) déjà obtenue dans un autre pays de l’Union européenne. Et dans les faits, ces dossiers ne semblent que rarement aboutir.
Reste donc à disposition des producteurs le système de demande de dérogation 120 jours, qui, aux dires du ministère, est sollicité par toutes les filières et augmente année après année. Movento (spirotétramate) qui vient à nouveau d’en obtenir une, n’est par exemple pas approuvé au niveau européen… Mais pas interdit non plus. Ce qui questionne l’avenir de la protection contre les pucerons sur betterave. « Nous faisons régulièrement des demandes sur riz mais mieux vaut s’attaquer à la base du problème », complète Geoffroy de Lesquen, président de la commission environnement de l’AGPB (Association générale des producteurs de blé).
« Dysfonctionnements » de l’Anses
La profession pointe ainsi des « dysfonctionnements » au sein de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation). « À partir du moment où une molécule est autorisée en Europe, il faut qu’elle soit disponible en France, insiste Franck Laborde, président de l’AGPM (Association générale des producteurs de maïs). Il nous faut obtenir cette avancée notamment par la proposition de loi Duplomb-Menonville « visant à lever les freins à l’exercice du métier d’agriculteur ». »
Avec plus de 400 amendements déposés, son examen a d’ailleurs débuté mardi 6 mai à l’Assemblée nationale. L’Article 2 permettrait notamment d’autoriser des dérogations de certains néonicotinoïdes, comme l’acétamipride, auparavant employé sur noisette ou pomme. Cet insecticide est en effet utilisé dans d’autres pays d’Europe mais la France l’a interdit depuis septembre 2018.
Une mesure à laquelle de nombreuses organisations de protection de l’environnement s’opposent avec vigueur. C’est notamment le cas de l’Unaf (Union nationale de l’apiculture française), qui a réaffirmé sa position en conférence de presse à l’Assemblée nationale quelques minutes avant le début de l’examen du texte en commission.








