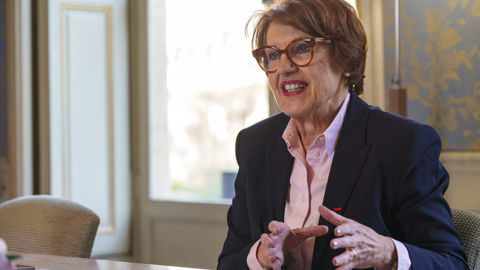Au Sommet de l’élevage (Puy-de-Dôme, du 7 au 10 octobre), la FNSEA et la Confédération paysanne, d’ordinaire opposées sur les dossiers, ont chacun de leur côté ciblé l’accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay), jugé « toxique » pour l’élevage français. « Nous sommes sur deux planètes différentes, et il est temps [pour la France] de faire un choix », a martelé le président de la Fédération nationale bovine (FNB), Patrick Bénézit, lors d’une conférence organisée par la FNSEA et Jeunes Agriculteurs.
La Commission européenne continue d’avancer à marche forcée sur le sujet, avec l’objectif que le volet commercial de l’accord puisse être ratifié d’ici à la fin de l’année. Elle a publié, le 8 octobre 2025, le texte détaillant le mécanisme de clauses de sauvegarde présenté au début de septembre et censé rassurer les filières.
Il offre « des garanties additionnelles en plus de l’introduction progressive de quotas d’importation définis pour les secteurs sensibles », souligne l’institution. Le texte vise à intégrer dans le droit de l’Union européenne, de manière contraignante et immédiatement exécutoire, les dispositions de sauvegarde prévues dans l’accord, en permettant « le retrait temporaire des préférences tarifaires » en cas d’effet négatif sur les filières agricoles européennes.
Spécificité des « produits sensibles »
Le règlement concerne un large panel de produits agricoles et précise dans son annexe une liste de 23 produits « sensibles » visés par des mesures spécifiques, dont notamment la viande bovine, y compris celle de « haute qualité », de porc et de volaille, le fromage, les œufs, le maïs et le sorgho, ou encore le sucre, l’éthanol et le biodiesel. Pour les produits sensibles, la Commission promet un « suivi renforcé » avec l’envoi « tous les six mois », au Conseil et au Parlement européen, d’un rapport « évaluant les incidences de ces importations sur les marchés » permettant des « actions rapides pour remédier aux impacts négatifs potentiels ». La Commission enquêtera « sans délai » si les prix de produits en provenance des pays du Mercosur sont au moins 10 % inférieurs à ceux de mêmes produits (ou de produits concurrents) européens, et si, en comparant à l’année précédente, les volumes annuels importés augmentent de plus de 10 % ou si les prix à l’importation des produits en question baissent de plus de 10 %. Pour les produits sensibles, elle s’engage à activer les mesures de sauvegarde provisoires au plus tard sous 21 jours suivant la réception de la demande.
Clause de sauvegarde
Mais les propositions de la Commission ne convainquent personne, ni les syndicats qui s’interrogent sur la manière dont ce règlement « unilatéral » pourra être contraignant, ni les filières, notamment viande, sucre et volaille, qui assurent que les critères d’activation du processus ne seront pas opérants.
« Une clause de sauvegarde, c’est pour faire face à une crise ponctuelle, pas à un problème structurel », explique Maxime Combes, économiste du collectif national Stop Mercosur, dont la Confédération paysanne fait partie. « On est simplement en train de dire aux producteurs : OK, on sait que vous allez disparaître, mais on va essayer que ce soit un peu moins rapide. » « Il n’y a qu’une seule posture politique acceptable : un non ferme et définitif », insiste Stéphane Gallais, porte-parole de la Confédération paysanne.
« Si les pays du Mercosur ne donnent pas leur accord sur cette clause de sauvegarde, alors son avenir est en pointillé, alerte l’eurodéputé Pascal Canfin (Renew) contacté par La France Agricole. Sans cet accord, le mécanisme de rééquilibrage s’imposera à la clause de sauvegarde ». Ce dernier permet aux pays du Mercosur de demander des compensations, prioritairement dans le secteur concerné.
Après vingt-cinq ans de négociations, l’accord a été finalisé le 6 décembre 2024, puis adopté par la Commission en septembre dernier. Le texte est désormais transmis aux 27 États membres pour ratification. Mais tout n’est pas perdu, selon les syndicats, qui identifient deux étapes où l’accord peut encore être bloqué. À condition que la France sorte du bois.
Minorité de blocage
C’est la bataille la plus imminente : d’ici à la fin de novembre, peut-être au début de décembre, les 27 chefs d’État et de gouvernement devront se prononcer au Conseil de l’Union européenne. Pour que l’accord passe, il faut une « majorité qualifiée », soit au moins 15 pays représentant au moins 65 % de la population européenne. Il suffirait que quatre pays représentant plus de 35 % de la population européenne votent contre pour faire échouer le texte.
Au Salon de l’agriculture, en février 2025, Emmanuel Macron avait assuré continuer de chercher cette « minorité de blocage » au sein de l’Union européenne. Mais selon les syndicats, la France ne fait pas le travail diplomatique nécessaire. « La représentation française à Bruxelles ne collabore pas avec les autres ambassades européennes pour progresser sur cette question », accuse Maxime Combes. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, confirme : « L’Élysée n’a pas clairement affirmé sa position à ce stade. »
Lobbying auprès des eurodéputés
Dernier rempart au cas où le Conseil valide l’accord : le Parlement européen, où le dossier du Mercosur divise à l’intérieur même des groupes politiques. « On nous dit que le vote des eurodéputés ne sera qu’une formalité, je pense que c’est beaucoup plus nuancé que cela », affirme Arnaud Rousseau. Car le Mercosur est l’accord commercial le plus contesté de l’histoire de l’Union européenne, « probablement encore plus que les négociations avec les États-Unis autour Tafta », selon Maxime Combes.
Habituellement, les députés votent selon leur famille politique. Mais sur le Mercosur, « il n’y a pas de blocs monolithiques », souligne Maxime Combes. Si les Verts et la Gauche sont quasi assurés de voter “non”, l’équilibre dépendra des décisions du PPE (droite européenne majoritaire), des Socialistes et de Renew — groupes profondément divisés selon les intérêts agricoles nationaux. Pour faire basculer les “flottants”, « on continue le travail [de lobbying] sur les eurodéputés », assure Arnaud Rousseau.
Suspendre la ratification
Autre voie possible pour au moins ralentir le processus de ratification de six mois à un an : saisir la Cour de justice européenne (CJUE). « Le cœur de la saisine est la menace qui pèse sur notre souveraineté, explique Pascal Canfin. Avec ce mécanisme, on soumet notre souveraineté réglementaire, qui est garantie par des traités, à un droit à compensation. » Avec d’autres parlementaires, Pascal Canfin planche sur une initiative collective et transpartisane. « Aujourd’hui la question est d’avoir une majorité au Parlement pour demander la saisine de la CJUE, explique l’eurodéputé. Le vote en plénière devrait se tenir en novembre. Si on obtient la majorité, la saisine sera automatique, puis la ratification sera suspendue le temps que la CJUE rende sa décision. »