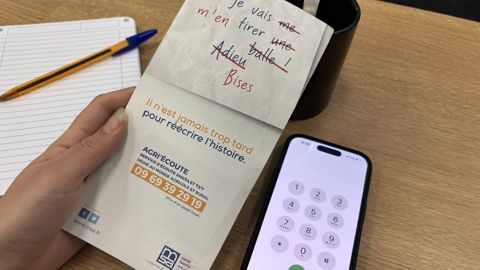Le bond de la production laitière des Pays-Bas entre 2014 et 2016 (+ 2 milliards de litres) a largement contribué à la déstabilisation du marché européen lors de la crise de la fin quotas. D’autant que cette progression s’est faite aux dépens de la réglementation environnementale du Vieux Continent. Le plafond d’émissions de phosphore ayant été dépassé à plusieurs reprises, des « quotas phosphore » ont été mis en place début 2018. La course aux volumes s’achève.
La grande envolée+ 40 %de production laitière entre 2005 et 2016
Entre 2005 et 2016, la collecte laitière néerlandaise est passée de 10,5 milliards à 14,5 milliards de litres de lait de vache, avec une nette accélération à partir de 2014. Un record historique. En prévision de la sortie des quotas laitiers, « la croissance a été préparée via une politique fiscale et une transition qui ont habilement fait basculer les capacités d’investissement des exploitations de l’achat de quotas vers les bâtiments d’élevage », explique l’Institut de l’élevage (Idele), dans son dossier « L’Europe laitière du Nord dans l’après-quotas » (2019).
« Cette course à l’agrandissement était également motivée par l’idée que les réglementations environnementales ne pourraient que se durcir et que tout acquis serait garanti. » Et pour cause. « Si cette hausse de la production est assez facilement explicable en raison de la forte compétitivité de la filière laitière néerlandaise tant au niveau européen que mondial, il est clair désormais qu’elle n’a été possible qu’en s’exonérant de l’application de la réglementation environnementale pendant plusieurs années », avance l’Idele, dans une étude de 2017 (1).
Pour expliquer la compétitivité de la filière, l’Institut fait référence à l’hyperspécialisation des élevages locaux : 450 tonnes de lait/UTH, 15 tonnes de lait/ha, moindre lien au sol et presque 100 vaches par ferme. Avec l’Irlande, « les exploitations laitières néerlandaises sont les plus rentables d’Europe ».
Des quotas laitiers aux quotas de phosphore
En 2015 et 2016, entre autres, le « plafond phosphore » du pays a largement été dépassé. Pour le secteur laitier, il est fixé à 85 millions de kg par an. « Or, le respect de ce plafond est une des conditions du maintien de la dérogation à la directive nitrates qui permet aux élevages laitiers néerlandais d’épandre jusqu’à 230 ou 250 kg d’azote/ha » selon les régions, rappelle l’institut technique. En parallèle, « environ 43 millions de kg d’azote et 41 millions de kg de phosphates organiques ont été exportés hors du territoire des Pays-Bas en 2016, soit deux fois plus qu’au début du siècle », souligne l’Idele.
En 2017, un plan de maîtrise est lancé avec notamment une subvention pour les cessations d’activité. S’ensuit la mise en place des quotas de phosphore en 2018 : 43 kg/vache/an. « Ce système [annoncé en 2015] attribue à chaque exploitation des droits individuels d’émissions de phosphore basés sur le nombre de laitières détenues au 2 juillet 2015, explique l’Idele. Les droits phosphore étant monnayables, les éleveurs désirant agrandir leur exploitation peuvent en acquérir sur le marché, auprès de ceux qui réduisent leur cheptel ou cessent leur activité. »
Changement de cap en 2016- 13 %de vaches laitières entre 2016 et 2018.
De 1,8 million de vaches laitières en 2016, plus haut niveau atteint depuis les années 90, le cheptel néerlandais est tombé à 1,55 million de têtes en 2018. « Après s’être stabilisée en 2017, la collecte a reculé de 3 % en 2018 », chiffre l’Idele. La hausse de la productivité et de l’âge de réforme des vaches a permis de limiter la casse. Depuis l’été 2019, les données de la Commission européenne font néanmoins état d’une nouvelle progression de la collecte. Sur le premier quadrimestre 2020, la collecte progresse de 3,2 % sur un an.
Si la problématique du phosphore semble résolue, de nouveaux défis se font jour. L’apport croissant de concentrés dans la ration des laitières complique la réduction des émissions d’azote, en dépit du recul du cheptel. « Entre 2012 et 2015 11,8 % des stations de suivi de la qualité de l’eau souterraine présentant des concentrations en nitrates supérieures à 50 mg/l », relève Sylvain Foray de l’Idele, lors de la conférence Grand Angle Lait le 19 juin 2020.
Concernant l’ammoniac, le plafond d’émission national (128 000 tonnes/an) a également été dépassé à quatre reprises depuis 2010, après un repli des émissions de presque 70 % entre 1990 et 2010. Dans le cadre de la directive européenne NEC (2), le pays doit réduire de 13 % ses émissions NH3 d’ici 2029 (par rappot à 2005). La filière ambitionne une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 49 % entre 1990 et 2030. En 2018, la réduction effective n’était que de 15 %. Friesland Campina, le principal collecteur néerlandais avec 70 % du lait, vise la neutralité carbone d’ici 2050.
En quête de valeur ajoutée
« Des débats très intenses ont lieu pour savoir quelle direction doit prendre l’élevage, explique Christophe Perrot, de l’Idele. Mais une piste principale est déjà engagée : la valeur ajoutée comme alternative aux volumes. » Et le pays n’est pas novice dans le domaine.
« Le lait néerlandais collecté est transformé en produits à forte valeur ajoutée (en fromages pour 54 % du lait en 2015), permettant de payer aux producteurs un prix du lait réel fluctuant mais presque toujours plus élevé que dans les autres grands pays exportateurs européens : 371 €/1 000 litres de lait en moyenne sur 2007-2015 », indique l’Idele.
De plus, « les Pays-Bas sont les précurseurs européens sur le lait de pâturage, estime Benoît Rouyer, du Cniel, l’interprofession laitière. 80 % des exploitations locales suivent le cahier des charges de la fondation du pâturage (Stichting Weidegang), avec un minimum de 120 jours/an et 6 heures/jour. »
En parallèle, de nouvelles segmentations émergent, comme le label durable « On the way to planetproof » axé sur le bien-être animal, le respect de la nature et du climat. Le bio gagne également du terrain, et pèse désormais pour 2 % de la collecte nationale.
(1) « Filière laitière aux Pays-Bas : hyper-competitivite ou dumping environnemental ? », par Ch. Perrot, S. Foray et J-M. Chaumay de l’Institut de l’élevage (juin 2017)(2) La directive NEC (National emission ceillings) fixe les plafonds d’émission nationaux NH3