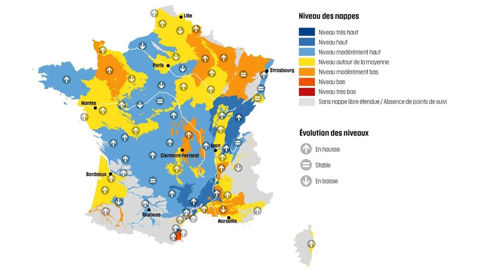1. « Le maïs consomme
trop d’eau »
La culture est souvent stigmatisée pour sa consommation en eau et son irrigation. « Toutes les cultures ont besoin d’eau, défend Thomas Joly, animateur de la filière maïs chez Arvalis. Ce qu’on peut reprocher au maïs, c’est d’en consommer quand il n’en tombe pas. »
En France, 25 % seulement des maïs sont irrigués. « Les trois quarts poussent en pluvial (65 % dans le cas du maïs grain et 90 à 95 % pour le fourrage), car on le place dans des situations où le contexte est favorable : des sols profonds, en fond de vallée, zones inondables l’hiver, ou zones où il pleut abondamment, poursuit l’ingénieur. L’irrigation, sans laquelle il serait difficile d’implanter une culture d’été, intervient dans des secteurs disposants d’une ressource en eau permettant un apport d’eau régulier, en lien avec les besoins de la plante. Et le maïs est celle qui valorise le mieux l’eau apportée. » La plante est particulièrement efficiente : selon Arvalis, le gain de production moyen par tour d’eau de 30 mm s’élève à 13,5 q/ha pour le maïs, contre 7,5 q/ha pour le blé.
L’irrigation garantit de bonnes conditions sur les phases clés de son cycle : pour la fécondation puis le remplissage des grains. « Le maïs est sensible au déficit hydrique lors de la floraison. À partir de 10 feuilles, les besoins en eau de la plante augmentent. Un stress durant cette période peut affecter les composantes du rendement, et donc le potentiel », explique Thomas Joly. L’irrigation sécurise qualité et quantité : l’enjeu est fort pour la filière des semences, une production à forte valeur ajoutée.
« L’agriculteur cherche un optimum économique rappelle l’ingénieur. Son objectif n’est pas forcément d’aller chercher les derniers quintaux, mais de trouver un équilibre entre rendement et charges investies. »
Le réchauffement climatique change-t-il la donne ? « Il raccourcit le cycle de culture, et peut imposer des changements de conduite, sur les dates de semis, les précocités, mais il n’est pas évident que l’on consommera plus d’eau, avance l’expert. On constate cependant des à-coups climatiques : la quantité de pluie reste la même, mais ne tombe pas au bon moment. Les réserves sont un moyen de tamponner cet effet : stocker l’eau et la distribuer régulièrement permet d’améliorer l’efficience de la plante. »
2. « Sa monoculture dégrade la fertilité des sols »
« Cela fait deux réformes de la Pac où l’UE veut casser la monoculture de maïs sur des questions idéologiques, selon laquelle la fertilité des sols serait mise à mal. C’est une idée reçue, affirme Thomas Joly. Prenez l’exemple de l’Alsace : les rendements augmentent chaque année. » En France, la monoculture longue durée de maïs représente 100 000 à 150 000 ha. Elle est stratégique pour valoriser certains territoires. « Le maïs répond à des contraintes locales, soulève le spécialiste. Dans les marais par exemple, ou en fond de vallée, dans une zone inondable où implanter une culture d’hiver est risqué voire impossible, ou encore dans le Sud-Ouest où la pluviométrie importante au printemps est favorable au développement de maladies d’autres cultures. »
Après la récolte, tiges et feuilles du maïs grain sont broyées et enfouies. « Le mulching, en remettant une part importante de biomasse au sol, permet de stocker du carbone et augmente le taux de matière organique », ajoute Thomas Joly. Selon l’AGPM, la sole française de maïs capte ainsi 80 Mt de CO2 et 8 Mt de CO2 sont réinjectés dans le sol via la décomposition des résidus.
La monoculture, un problème avant tout politique donc ? « On peut discuter de son impact sur le paysage, mais pas sur la fertilité : les chiffres le montrent », affirme Thomas Joly. La monoculture du maïs fourrage répond, quant à elle, à d’autres contraintes. « Elle permet parfois d’assurer un fourrage d’hiver en conditions difficiles, en montagne par exemple, ou de préserver un bocage à côté », illustre l’ingénieur.
3. « Le maïs est gourmand en azote »
« C’est une plante qui fait beaucoup de biomasse : il faut l’alimenter à hauteur de son potentiel. À la tonne produite, elle est très efficiente », rappelle Thomas Joly. Arvalis chiffre le besoin unitaire en azote entre 2,1 et 2,3 kg N/unité de production pour le maïs grain, suivant le potentiel de production. Le maïs, en tant que culture d’été, profite aussi de la minéralisation estivale de la matière organique des sols. Celle-ci est d’autant plus importante si la parcelle est irriguée.
« Le principal débouché du maïs est l’alimentation animale. Un cercle vertueux s’installe dans les exploitations de polyculture-élevage. Une part importante de la surface en maïs permet de valoriser les effluents », précise l’ingénieur.
4. « Le maïs est beaucoup traité »
Le recours aux phytos est limité sur maïs. « La plante est peu sensible aux maladies, notamment grâce à la sélection variétale. Les hybrides n’ont pas besoin de fongicides, sauf maïs spéciaux (semences ou maïs doux) en raison d’engagements de qualité sanitaire, explique Thomas Joly. L’utilisation d’insecticides n’est pas automatique, elle dépend du secteur. »
Le maïs est ainsi l’une des cultures les moins traitées. Son indice de fréquence de traitement (IFT) est faible. Estimé en 2017 par Agreste à 2,4 pour le maïs fourrage et à 2,8 pour le grain (traitements de semences compris), l’indicateur reflète essentiellement le désherbage, un « passage obligatoire » pour limiter la nuisibilité des adventices. « Le maïs a l’avantage d’être implanté à des écartements importants, ce qui permet de biner », souligne le spécialiste. Les deux techniques, mécanique et chimique, peuvent aussi être combinées, avec un traitement localisé sur le rang, tandis que l’interrang est biné. « Cela permet de diviser les doses par trois, puisqu’un tiers de la surface seulement est traité », précise Thomas Joly. Il prévient : « Ces alternatives à la chimie sont plus exigeantes en temps, sont fonction des conditions climatiques et plus coûteuses. Sans les généraliser tous les ans, ce sont des solutions à conserver pour réduire l’usage de la chimie. »
Le maïs fait également figure d’exemple en matière de protection intégrée, avec l’utilisation de trichogrammes pour lutter contre la pyrale. Lâchées au bon moment, ces microguêpes parasitent efficacement les œufs du ravageur. Selon l’Acta, entre 500 000 et 600 000 hectares de maïs étaient protégés par cette technique au cours de l’année 2018.