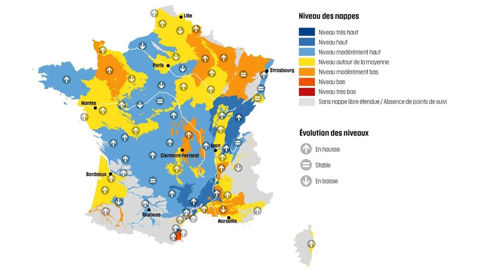On sentait depuis 2014 les pouvoirs publics impatients de réglementer les pics de pollution de l’air, au-delà du seul trafic routier. Le pas vient d’être franchi en direction de l’agriculture, avec un arrêté qui donne pouvoir aux préfets de reporter épandages de fertilisants et travail du sol, sans discontinuer, tant que les conditions météo propices à ces épisodes perdureront (voir page 17).
Ces deux points vont assurément crisper dans les campagnes, même si l’arrêté promet au préalable une concertation avec la profession agricole. En 2014 justement, au sortir d’un printemps particulièrement pluvieux, le ministère de l’Agriculture s’était fait vertement rabrouer en conseillant de tels reports, ce qui avait été perçu comme de l’amateurisme et de la provocation. Quel préfet osera sortir un tel arrêté d’interdiction, sachant qu’à cette période de l’année, l’activité dans les champs est particulièrement intense et qu’il faut avant cela composer avec le calendrier d’épandage des zones vulnérables ? A quelques jours près, tout agriculteur sait que c’est la réussite d’une saison entière qui peut se jouer. Notons au passage que la promesse, faite par Manuel Valls, d’une pause réglementaire s’est envolée… en fumée.
Si l’agriculture est aujourd’hui clairement ciblée, c’est à cause de ses émissions d’ammoniac, qui peuvent se combiner avec les oxydes d’azote des véhicules et de l’industrie pour former des particules fines. Et la France est comme d’autres États sous pression d’un contentieux ouvert par Bruxelles pour les particules de moins de 10 microns (PM 10). Il fallait donc donner des gages. Mais par cet arrêté, l’État met finalement sur un même plan de nocivité les particules provenant du diesel et les émissions de l’agriculture. Et pourtant, étonnamment, on ne sait pas encore si c’est la taille de ces particules plus que leur composition chimique qui crée la toxicité. Pour preuve, l’Anses étudie encore cette question et ses résultats ne seront pas connus avant 2017...