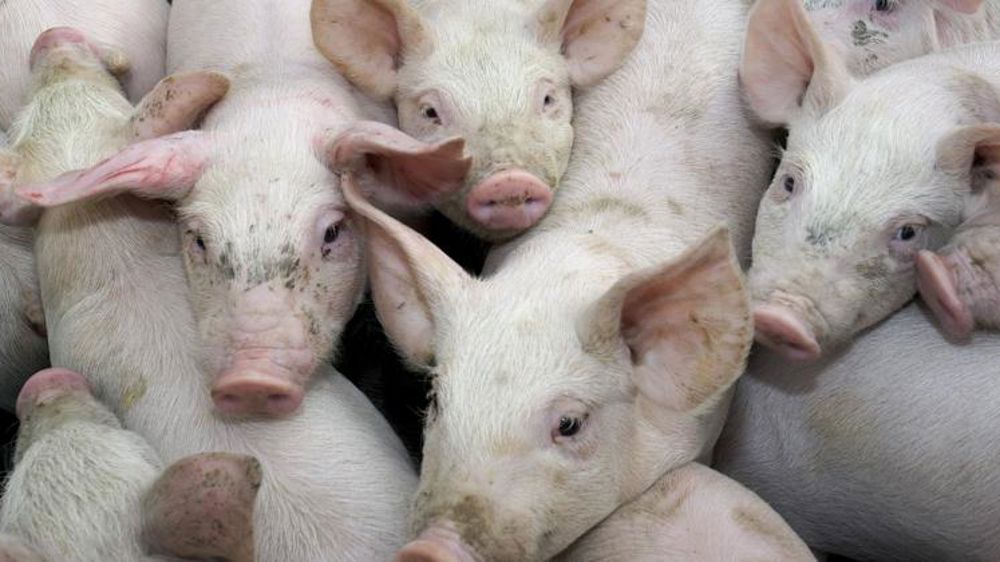En cas de confirmation officielle de la peste porcine africaine dans la faune sauvage française, le ministère de l’Agriculture détaille dans une instruction technique les mesures de prévention et de lutte à mettre en œuvre en élevage de porcs et de sangliers situés en zone infectée.
« Elles seront réévaluées quelques semaines après la confirmation du cas quand la connaissance de l’extension de l’infection aura été affinée, précise le ministère. Il convient de garder à l’esprit qu’elles pourront s’étaler sur une période supérieure à 2 ans. »
Examen de tous les animaux
Un audit du niveau de biosécurité de l’ensemble des élevages de suidés (élevage de porcs et de sangliers) de la zone infectée (ZI) est réalisé au moyen d’une grille standardisée par les vétérinaires sanitaires des exploitations. Les élevages en plein air et ceux utilisant un paillage sont visités en priorité.
La visite du vétérinaire sanitaire est programmée rapidement dans chacun de ces élevages pour examiner chaque animal et vérifier le respect des règles de biosécurité. Cette visite entre dans le cadre de la police sanitaire et à ce titre est prise en charge de l’État. Une synthèse des pratiques d’élevage est également réalisée par chaque DDecPP (1) ou la Draaf (2). En cas de non-conformité aux prescriptions de l’arrêté ministériel, « des mesures administratives seront mises en œuvre sans délai en lien avec la DGAL et feront l’objet d’un suivi scrupuleux »
Suivi clinique hebdomadaire
Tous les élevages de suidés feront l’objet d’un suivi clinique hebdomadaire par le vétérinaire sanitaire établissant l’absence de signes cliniques évocateurs de peste porcine (africaine et classique). « Sans préjudice d’une déclaration spontanée par l’éleveur, le vétérinaire sanitaire contacte chaque semaine l’éleveur afin de l’interroger sur d’éventuelles mortalités dans son élevage et la présence d’éventuels signes cliniques évocateurs. »
Ce dispositif pourra être adapté dans les régions où la densité de cheptels est forte, sur la base d’une analyse de risque prenant notamment en compte le résultat des audits de biosécurité. Les critères de suspicion clinique à retenir pour la zone sont ceux définis par instruction. « En outre, le seuil de mortalité est abaissé à un porc reproducteur ou deux porcs charcutiers sur une semaine, âgés de plus d’un mois », souligne le ministère. Un suivi des suivis sanitaires rapprochés effectués par les vétérinaires sanitaires sera également réalisé par la DDecPP.
(1) Direction départementale en charge de la protection des populations.
(2) Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.