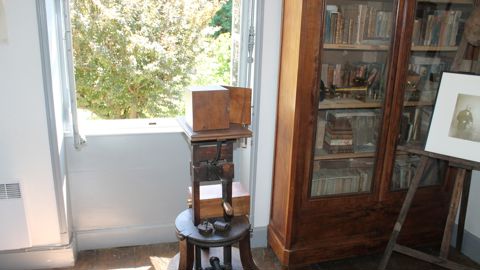«Hier, il est tombé 500 mm sur le volcan en trois heures. Ici, on n’a pas dû être loin des 400 mm », maugrée Virginie K’Bidi, au volant de son tracteur. Les ravines ont débordé provoquant des éboulis et des effondrements de terrain.
L’engin avance au pas de cheval sur les pentes raides vers les champs de canne à sucre d’une insolente vivacité. À l’île de La Réunion, la nature est excessive en tout point, depuis ce volcan, le piton de la Fournaise, en éruption chronique, en passant par les ouragans aussi imprévisibles que dévastateurs. La contrepartie est l’incroyable fertilité des sols volcaniques et la luxuriance de la végétation.
Une culture antiérosive
C’est d’ailleurs à la faveur des cyclones qu’au XIXe siècle, les champs de canne à sucre ont remplacé les cultures traditionnelles de café et de cacao. Car, comme le roseau de la fable de La Fontaine, la canne à sucre ne rompt pas, elle plie sous les assauts du vent.
Les plantations ourlent les bas de l’île, à une altitude comprise entre 200 et 600 m, léchant presque l’océan Indien. Elles occupent plus de la moitié de la SAU (surface agricole utile) de l’île. « Cela en fait une culture antiérosive et sans la canne, les dégâts de la pluie d’hier auraient été encore plus dramatiques », explique Virginie.

Le tracteur avance dans la parcelle de canne à sucre dont une petite partie a déjà été coupée. La saison de la récolte a commencé début août et elle va durer jusqu’à la fin décembre, au pic de l’été, dans l’hémisphère sud. À l’horizon, une chape de nuages se dessine au-dessus d’une mer d’un bleu outremer. Le soleil cogne. Virginie empoigne sa machette. D’un geste vif et répété, elle cisaille la plante à la base, puis débarrasse la tige de ses feuilles desséchées. « Je travaille comme mes ancêtres à la main, indique-t-elle, le visage déjà perlant de sueur. La machine ne peut pas opérer dans ces terrains accidentés. »
La famille de Virginie est arrivée de Bretagne il y a déjà trois siècles et depuis cinq générations, elle cultive la canne à sucre sur les hauteurs entre Saint-Philippe et Saint-Pierre, dans le sud de l’île. En deux jours, l’exploitante coupe le tonnage d’une remorque, c’est-à-dire entre 9 et 10 t. À ce compte-là, il lui faudra presque six mois pour récolter ses 3,5 ha. Le rendement est d’environ 80 t/ha. « La récolte est la partie la plus compliquée de cette culture, poursuit l’agricultrice. Si j’emploie un cueilleur, il va me coûter presque le tiers de ce que la canne m’est payée. Et de toute façon, c’est de plus en plus compliqué de trouver de la main-d’œuvre. »
Une fois coupée et « nettoyée », la canne est jetée en fagots sur le sol, puis à la fin de la journée, à l’aide d’une pelleteuse mécanique à crochets, elle est chargée dans la remorque. Virginie taille l’embout d’une tige et le porte à la bouche pour le mâchouiller et apprécier la richesse en saccharose. Elle grimace : « À cause de la pluie qui n’arrête pas depuis quelques jours, la canne n’est pas très sucrée. Elle a besoin de sécheresse pour faire du saccharose. »
Six ou sept récoltes
Dès la coupe, le cycle recommence et à partir de l’un de ses stolons, la graminée tropicale repousse. Après six ou sept récoltes, la plantation épuisée est renouvelée. La culture n’est pas très gourmande en intrans. « Essentiellement des herbicides dont le nombre de passages dépend de la pluviométrie, entre 3 et 4 », précise la cheffe d’exploitation. Comme la canne atteint très vite des sommets (entre 3 et 5 m), les derniers traitements doivent se faire au pulvérisateur à dos !
C’est l’heure du « voyage » comme disent les 2 700 planteurs de La Réunion. Le tracteur ainsi que la remorque chargés redescendent vers la balance du Baril. La pesée du chargement est suivie de la prise d’un échantillon par une carotteuse. Le taux de sucre (entre 11 et 15 %) détermine le prix d’achat de la canne : « À raison de 5 euros le point, entre la fourchette basse et la haute, la variation peut être de 50 euros sur une cargaison de 10 t. » La canne de Virginie sera acheminée dans l’une des deux sucreries de l’île. Elle sera transformée en sucre roux et les co-produits, la bagasse (déchet de la canne) et la mélasse (déchet du sucre), sont respectivement la matière première de la centrale électrique de l’île et de la fabrication du rhum.
Jean-Paul Frétillet