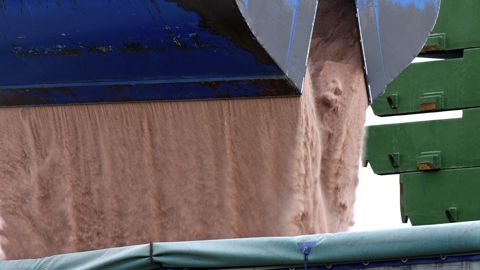Après un demi-siècle de bons et loyaux services, la méthode du bilan prévisionnel qui permet de raisonner la fertilisation azotée cède du terrain. Bien qu’elle soit toujours utilisée, l’Inra et Arvalis travaillent à la mise en œuvre de méthodes optimisées (lesquelles sont encore au stade de test) sur le blé. Malgré des interactions fortes entre les deux instituts (notamment via la thèse Inra-Arvalis-Ademe, de Clémence Ravier, de 2013 à 2017), le premier planche davantage sur Appi-N, tandis que le second se dédie à CHN-conduite. Ces deux approches sont similaires puisqu’elles ne prennent plus en compte l’objectif de rendement, que les agriculteurs tendent à fixer comme un chiffre espéré plutôt qu’une moyenne quinquennale (moins les deux extrêmes). Et contrairement à la méthode du bilan, elles permettent un pilotage intégral, tout au long du cycle de la culture. En effet, elles se basent sur un suivi régulier de l’indice de nutrition azotée (INN) de la sortie de l’hiver à la floraison (*). L’idée est de maintenir la culture au-dessus d’une trajectoire plancher de l’INN. Si la culture est dans ce cas de figure et s’il n’y a aucun risque de passer sous le seuil jusqu’à la prochaine période de conditions climatiques favorables pour valoriser l’engrais, aucun apport n’est recommandé. Ainsi, des carences précoces sont tolérées par le blé sans perte de rendement (en théorie) ni altération de la qualité des grains (teneur en protéines stable), ce qui permet de repousser la date du premier apport. « Ces deux méthodes privilégient les apports plus tardifs qui améliorent le coefficient apparent d’utilisation (CAU) de l’azote contenu dans l’engrais apporté », souligne Baptiste Soenen, ingénieur Arvalis. Cela permet par conséquent de réduire les pertes dans l’environnement (lire l’encadré témoin).
Gagner en autonomie
En revanche, les deux approches se différencient par leur philosophie. Appi-N (dont les règles de décision se basent sur le modèle Azodyn-blé) a vocation à être utilisée par les agriculteurs, de façon autonome, pour qu’ils déterminent eux-mêmes la date et la dose d’azote à apporter. « Les exploitants, comme ceux du groupe test dans l’Eure, se créent un référentiel commun. Ils ont un vrai rôle, sont acteurs de la prise de décision. Ils pincent trente feuilles de blé avec un chlorophylle-mètre (NDLR : type N-Tester de Yara ou Greenseeker de Trimble) dans leur champ et obtiennent une valeur qui, via un modèle, est traduite en INN. La relation qui a été trouvée présente une erreur assez importante, alerte l’ex-thésarde. Elle n’est certes pas parfaite, mais donne une idée de l’état de nutrition azotée de la plante. »
Déclencher l’apport quand le besoin est réel
Lorsqu’un passage s’avère nécessaire d’après la mesure d’INN, la dose à apporter est fournie par des abaques issus de l’analyse des vingt dernières années climatiques (lesquels devront être mis à jour tous les cinq ans). Ces tableaux intègrent plusieurs critères : le climat de la région, la capacité du sol à fournir de l’azote et notamment le précédent et la richesse du sol en azote organique, la texture… Cette dose maintiendra l’INN au-dessus du seuil plancher, jusqu’à la prochaine période de conditions climatiques favorables pour valoriser l’engrais où il faudra à nouveau estimer l’INN.
La méthode CHN-conduite fournit ces mêmes informations - mais sans chlorophylle-mètre qu’Arvalis considère « peu satisfaisant » pour mesurer l’INN -via une plate-forme dans laquelle les paramètres des parcelles peuvent être intégrés pour un résultat plus précis. L’agriculteur perd malheureusement en autonomie. « Le modèle CHN (NDLR : pour carbone-eau-azote) tient compte du type de sol choisi dans une base de données régionales, de la météo grâce à la géolocalisation, de la variété dont les caractéristiques sont référencées dans une autre base de données, de la date de semis, et des pratiques comme l’irrigation et les apports d’azote (minéraux et organiques). Il simule quotidiennement les flux plante-sol-atmosphère, dont l’INN, dépendant de la biomasse et de l’azote absorbé. La trajectoire plancher est la même que dans Appi-N. Puis, la prise de décision pour la date et la dose à apporter se fait en ligne. Actuellement, on prévoit la quantité d’engrais à épandre au début de la culture avec la méthode des bilans, puis on pilote le dernier apport fin montaison, par exemple avec Farmstar. Cette nouvelle méthode permettra de déclencher l’apport au plus proche des besoins de la plante », analyse Baptiste Soenen.
Aussi, le reliquat sortie hiver ne fait plus l’unanimité. L’Inra s’en dispense dans Appi-N, alors que l’institut technique continue de l’utiliser car « il permet de corriger le modèle s’il dérive », justifie l’ingénieur Arvalis.
Des résultats motivants
Les premiers tests conduits sur blé durant la thèse auprès de deux groupes dans l’Eure et les Deux-Sèvres ont montré « une économie d’engrais entre 30 et 40 €/ha, un décalage de la date du premier apport (de zéro à quarante jours, selon les cas). Cette efficience azotée a été obtenue à rendement équivalent et avec une amélioration de la teneur en protéines des grains récoltés : atteinte du seuil de 11,5 % dans 70 % des situations, contre 50 % avec la méthode du bilan actuelle », explique l’Inra (lire l’encadré ci-contre). À entendre Bertrand Omon, de la chambre d’agriculture de l’Eure, qui encadre les tests chez les agriculteurs du département, la démarche a trouvé son public : « En 2016, ils ont eu des capteurs de prêt. En 2017, l’achat de ces derniers a été financé par l’agence de l’eau. En 2018, ils sont entrés dans une certaine routine. Le principe est solide, cependant la méthode nécessite d’être ajustée, notamment pour l’élargir au niveau national. »
Du côté d’Arvalis, les performances dans son réseau d’expérimentations France entière sont similaires : « CHN-conduite permet aussi une économie d’azote puisque la dose totale apportée est en moyenne inférieure à celle calculée avec la méthode du bilan pour obtenir un rendement équivalent, donc une meilleure efficience », ajoute Baptiste Soenen. En 2019, l’institut technique va poursuivre ses essais (au nombre de quatre-vingts) en collaboration avec de nombreux partenaires et des tests à grande échelle seront conduits chez les agriculteurs en 2020. « En 2020-2021, les premières utilisations par les exploitants hors cadre projets de recherches devraient être effectives. À noter qu’en termes de réglementation, les ministères sont déjà sensibilisés à l’intérêt de ces nouvelles méthodes », poursuit-il. Reste à les répliquer à d’autres cultures telles que le colza « qui tolère aussi les carences précoces en azote », ajoute Clémence Ravier. Isabelle Lartigot
(*) L’INN correspond au rapport entre la teneuren azote total des parties aériennes de la planteet la teneur minimale nécessaire à une croissance normale de la plante.