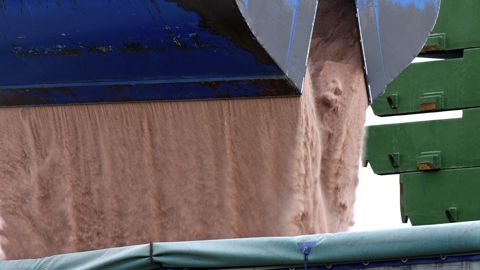Les zones de prairies peu intensives, de cultures peu exigeantes en phosphore ou céréalières, ont des sols à faibles teneurs en phosphore (P). Historiquement élevés du fait de forts apports à partir des années 1960, les stocks de phosphates dans le sol diminuent depuis 15 ans… au point que les « impasses » sur la fertilisation phosphatée sont parfois risquées.
La particularité du P est qu’il est très peu disponible : moins de 0,1 % du total est dans la solution du sol, et une partie de ses 0,1 %, retenue (1), ne peut être absorbée par les plantes. Pour augmenter son acquisition par la culture, plusieurs pistes sont envisagées.
Des pistes sur tous les fronts. Au niveau industriel, les formulations des engrais peuvent améliorer son accessibilité (libération prolongée, inhibition de la liaison du P au sol, meilleure solubilisation). Au niveau génétique, la sélection variétale crible des plantes utilisant moins de P ou l’acquérant plus efficacement. Au niveau agronomique, des essais ont montré que les associations de céréales et de légumineuses pouvaient faciliter le prélèvement de P en début de cycle ; et les pratiques favorisant la présence de vers de terre et de micro-organismes permettent une minéralisation du P de la matière organique.
(1) Les ions phosphates sont retenus (ou complexés) à la surface des argiles, de la matière organique, et surtout de composés chimiques (calcium dans les sols carbonatés, fer et aluminium dans les sols acides).