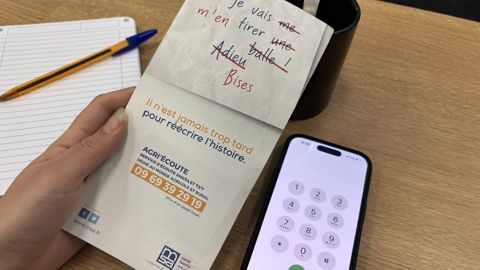Sur sa station de Lusignan, l’Inra teste « un système grandeur nature pour permettre à un éleveur laitier de vivre de son métier dans un système durable, tout en économisant l’eau, les énergies fossiles et les intrants, explique Sandra Novak, référente de ce programme intitulé Oasys.
Cette approche agroécologique met en cohérence les ressources fourragères avec le cheptel. » L’accès à l’irrigation a été délibérément écarté, pour se placer dans un contexte de forte contrainte sur l’eau.
Le système fourrager maximise le pâturage et utilise de nombreuses espèces végétales différentes. Le recours aux mélanges végétaux est utilisé chaque fois qu’il est possible. En plus des prairies associant graminées et légumineuses, des cultures fourragères annuelles sont implantées, comme le millet, le sorgho, le moha, associés à des légumineuses (trèfles, luzerne, pois, vesce…). Certaines sont destinées à être pâturées aux périodes délicates de l’été (chicorée, radis, navet, graminées estivales…) ou de l’hiver (méteil, betterave, colza…). « L’idée est d’avoir des cultures à double fin, qui, selon les conditions, sont soit pâturées, soit récoltées ensilées ou en grain, précise Sandra Novak. C’est, par exemple, le cas des méteils associant triticale, avoine, pois et vesce. Ensilés en mai, ils offrent un stock de bonne qualité et esquivent les périodes de sécheresse. Nous testons aussi plusieurs utilisations successives, avec pâturage avant montaison, puis récolte des repousses ensilées ou en grain, puis le pâturage des deuxièmes repousses, si besoin. Si le méteil est semé suffisamment tôt, en septembre, il est possible de le faire pâturer 1 à 2 h par jour en hiver. »
Enfin, des fourrages complémentaires sont cultivés pour constituer des stocks pour l’été et l’hiver, sous forme d’ensilage. Ils sont réalisés à partir de cultures diversifiées : maïs, sorgho, méteil… « L’idée est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, conclut Sandra Novak. De plus, ce système évite les pointes de travail en répartissant les chantiers, et permet d’exploiter au mieux les fenêtres météo. »
Agroforesterie. Des arbres et des arbustes ont été implantés pour fournir à terme une ressource pâturable complémentaire pendant les saisons creuses d’été et d’automne, en plus d’offrir de l’ombre aux animaux. « Nous verrons quelles espèces sont mobilisables pour le pâturage selon les saisons. »
Troupeau. Du côté des vaches laitières aussi, c’est la diversification qui prime. Le troupeau est mené en croisement trois voies associant les races prim’holstein (pour le niveau de production), rouge scandinave (pour les performances de reproduction) et jersiaise (pour la résistance au stress thermique, le lait plus riche et le petit gabarit). Par ailleurs, les vêlages sont groupés sur deux périodes, printemps et automne, et les lactations allongées à 16 mois contre 10 précédemment..