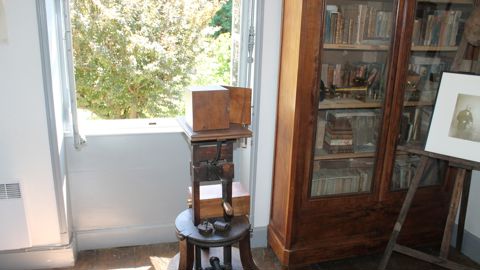Lors du « printemps maraîchin » qui a rassemblé, fin mars dans le sud des Deux-Sèvres, quelques milliers d’opposants aux réserves de substitution, sa station de pompage a été détruite. Ludovic Vassaux a crié sa colère en se filmant au milieu de son troupeau de vaches maraîchines. Il lui semblait pourtant cocher toutes les cases, lui qui a démarré sa vie professionnelle en assurant des formations à l’environnement, puis en devenant exploitant, en convertissant, avec l’accord de son associé, la ferme en bio.
Mais celle-ci dispose d’un forage et de 60 000 m3 de volume d’eau. Volume qui sera prélevé dans la réserve qu’elle partagera avec plusieurs voisins et qui fait partie des 16 réserves en projet sur le bassin de la Sèvre.
Entre marais et plaine
Alors que les opposants vilipendent « l’agrobusiness », « les mégabassines », on est ici loin du compte. L’exploitation, nichée derrière l’église d’Épannes, est à cheval sur des terres de marais et de plaine. Impossible d’obtenir d’excellents résultats sur toutes les parcelles. Les années sèches sont favorables à celles de marais grâce à leur forte réserve hydrique, et inversement les années plus humides où ces parcelles sont inaccessibles avant la mi-mai ou à partir d’octobre. Ludovic Vassaux y voit pourtant un atout. « Entre les deux types de terre, on trouve toujours un équilibre. »
À la tête de l’exploitation bio, deux associés, Ludovic Vassaux et Guillaume Raynaud. Ce dernier a succédé le 1er janvier 2022 à Jean-Claude Favrelière, qui a pris sa retraite. Leurs objectifs : valoriser le passage au bio, produire des semences et vendre la viande en circuits courts.

Les maraîchines sont en partie commercialisées en vente directe à la ferme et dans des cantines. Mais Ludovic admet la difficulté : « La vente directe est chronophage et les clients parfois déconnectés. Une cantine m’a commandé quatre langues de bœuf. Comment répondre à une telle demande ? »
L’effort porte aussi sur la réduction des coûts. En dehors de deux tracteurs, le matériel pour la fenaison, les moissons, le travail du sol est en Cuma. « Sur les 1 000 ha récoltés par cette dernière, la moitié sera en bio l’an prochain. Ça permet d’avoir du matériel spécifique et ça fait des appels du pied aux conventionnels », ajoute Ludovic avec malice .
L’eau, grand sujet de tensions en Poitou-Charentes, est vitale pour l’exploitation. Le volume initial de 110 000 m3 dans les années 1990 a été revu à la baisse en plusieurs étapes. Quand la Coop de l’eau s’est créée pour accompagner les projets des réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre, les irrigants ont eu le choix entre une prime en contrepartie de la cessation de l’irrigation ou un volume réduit, mais garanti, à travers une réserve de substitution. Cette dernière option retenue, le volume de l’exploitation est passé à 60 000 m3.
« Garder l’eau d’hiver »
De toutes les fermes reliées à la future réserve, celle de Ludovic et Guillaume dispose du plus gros volume. « Julien Leguet [le leader du collectif d’opposants aux réserves “Bassines non merci !”] veut créer une Zad à Épannes, alors que tout le monde est à moins de 60 000 m3 », s’agace Ludovic. Quand la réserve de substitution d’Épannes sera en service, trois forages cesseront de fonctionner pour favoriser les captages d’eau potable. C’est l’engagement pris par les agriculteurs en contrepartie de l’aménagement de la réserve. « Nous avons fait des efforts », souligne Jean-Claude Favrelière. Ludovic renchérit : l’exploitation compte 22 km de haies. « Cela représente 6 000 € d’entretien par an, 70 heures de débroussaillage. »
Jean-Claude Favrelière rappelle que les nappes sont ici de surface et très réactives. « Quand on voit le seuil de l’arrêté préfectoral qui approche, on cesse d’arroser et la nappe remonte. Ça permet de pousuivre la semaine suivante. » Quant à l’eau d’hiver, le plus souvent surabondante, elle inonde les prairies humides. « On n’empêchera pas le marais d’inonder en hiver. Le but des réserves est d’éviter de perdre trop d’eau et d’en garder pour les cultures, explique Ludovic. Les bassines vont nous coûter 6 000 € par an. Je suis prêt à les payer. Il faut garder en tête que les aides publiques aux réserves ne subventionnent pas l’agriculture mais l’environnement. » M. Guillemaud