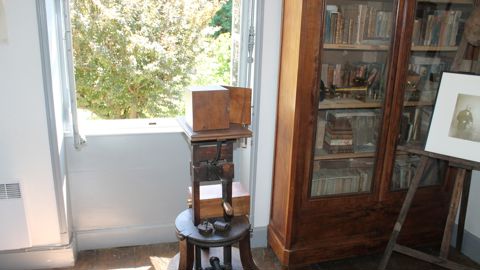La viande de laboratoire a fait sensation en 2013, lors de la présentation du premier burger. Son créateur avait alors affirmé que nous mangerions de la viande produite in vitro sept ans plus tard. Il n’en est rien. Une seule entreprise a reçu, fin 2020, une autorisation de mise sur le marché de nuggets à Singapour. Pourtant, on ne compte plus les levées de fonds des multiples sociétés et start-up qui se sont lancées. Diverses formes (steak, saucisse, boulette…) et viandes (poulet, bœuf, porc, canard, kangourou, wapiti, bison…) sont testées.
Pourquoi ces nouveaux produits n’ont pas encore abouti dans nos assiettes ? Pour Jean-François Hocquette, de l’Inrae, « il reste des verrous techniques. Dans un modèle de recherche privé, les start-up rendent le produit attrayant en affirmant que les problèmes de savoir-faire vont vite se résoudre, afin d’attirer et rassurer les investisseurs. »
Le premier obstacle est l’utilisation de sérum fœtal bovin dans le milieu de culture. Très cher, il pose aussi des questions éthiques puisqu’il nécessite d’abattre des vaches gestantes. La plupart des entreprises de viandes artificielles affirment ne plus en utiliser. Mais elles ne communiquent pas sur leurs recettes. « Le problème est qu’aucun organisme tiers ne peut vérifier la composition du milieu de culture », poursuit le chercheur.
Un autre souci concerne les lignées cellulaires. Pour qu’elles continuent de proliférer au-delà d’un certain seuil, cela requiert une manipulation génétique peu appréciée des consommateurs.
Parmi les autres défis techniques pas encore réglés, se trouvent le passage à la production à grande échelle dans des bioréacteurs et le support sur lequel les cellules s’accrochent et prolifèrent dans ces cuves. Là encore, on manque de transparence sur les procédés industriels.Léna Hespel