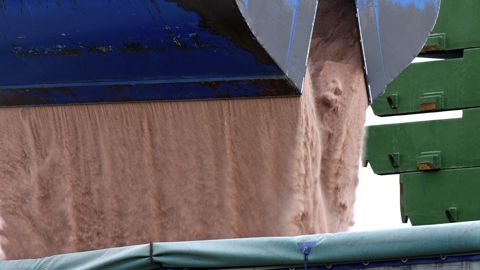C’est un record historique : le prix du gaz (TTF, référence du marché européen) a atteint un pic de 347 €/MWh le 26 août 2022, soit une hausse de 43 % en une semaine. « Depuis, les prix se sont un peu repliés, mais restent à des niveaux très élevés comparés à l’année dernière sur la même période (autour de 50-100 €/MWh) », souligne Alexandre Willekens, analyste chez Agritel.
Les conséquences du conflit russo-ukrainien
Ces hausses sont en grande partie dues au conflit russo-ukrainien, entre les restrictions d’approvisionnement de gaz russe et les opérations de maintenance du gazoduc reliant la Russie et le continent. La dernière en date, annoncée entre le 31 août et le 2 septembre 2022 a ainsi fait bondir les prix. Et les incertitudes sur la situation géopolitique en mer Noire continuent d’amener de la volatilité.
Le gaz étant une matière première nécessaire à la production d’ammoniac, lui-même servant à la fabrication des engrais azotés, les prix de ces derniers ont aussi grimpé : au 2 septembre, celui de la solution azotée était de 677,5 €/t (FOT Rouen) et celui de l’urée de 897,5 €/t (Franco France) selon Agritel.
Au 5 septembre, la tonne d’ammonitrate 33,5 affichait quant à elle un prix autour de 920 € (Franco France).
Usines à l’arrêt
Pour les fabricants européens d’engrais, essentiellement producteurs d’ammonitrate, le manque de visibilité sur les prix et les approvisionnements en gaz rend la situation très tendue : « plus de la moitié de la capacité de fabrication d’ammoniac est à l’arrêt en Europe, estime Nicolas Broutin, président de Yara France. Chez Yara, nous opérons à 35 % de notre capacité de production d’ammoniac : cela correspond à une perte de 4 millions de tonnes de production de produits finis annuelle au niveau européen », ajoute-t-il.
De son côté, Boréalis a annoncé avoir réduit et arrêté la production dans certaines unités de différents sites européens, « pour des raisons économiques ». Une opération de maintenance est également planifiée sur septembre-octobre, sur son site de Grandspuits en Seine-et-Marne.
Certaines usines importent directement de l’ammoniac pour la fabrication des engrais et sont, de ce fait, moins tributaires du gaz russe. Néanmoins, « les volumes ne sont pas illimités et à cela peut s’ajouter des problématiques logistiques », signale Jean-Luc Pradal, directeur de Fertiberia France.
Les opérateurs ont massivement recours à l’importation de produits finis, notamment de la solution azotée et de l’urée, en provenance d’Amérique du Nord, du Moyen Orient et d’Afrique du Nord.
Cette option est moins chère que de produire soi-même, même si la faiblesse de l’euro face au dollar depuis plusieurs mois n’est pas un avantage pour les importations européennes. Malgré ces achats, une rupture d’approvisionnement temporaire est possible selon le président de Yara France, avec une situation plus tendue pour l’ammonitrate.
Les engrais verts, dits décarbonés, constituent une solution à cette dépendance européenne vis-à-vis du gaz, mais les investissements nécessaires limitent leur déploiement à court terme.
D’autres formes d’engrais
Du côté des distributeurs, la plupart des structures contactées déclarent être couvertes pour les apports de février-mars. Il reste néanmoins des incertitudes quant à la deuxième partie de campagne. Grâce aux achats de solution azotée et d’urée, la situation ne semble pas être périlleuse à date.
« Mais cela suppose un changement pour les agriculteurs, qui ne vont peut-être pas avoir leurs formes d'engrais habituelles », souligne un opérateur de Normandie.
« Plutôt que de se concentrer sur deux formules, on passera à 5-6 formules pour aller chercher les unités d’azote », déclare un autre opérateur de Rhône-Alpes.
Même son de cloche en Seine-et-Marne et dans l’Oise, où l’écart de prix sur la valeur d’unité d’azote entre l’urée et l’ammonitrate est de 1 euro : « si on met 200 uN/ha sur un blé, cela fait 200 euros d’écart ! », insiste un responsable d’approvisionnement de ce secteur.
Les stratégies d’épandage devront donc être adaptées en fonction de la valeur et de la forme proposée (l’urée, par exemple, n’est pas adaptée à des largeurs d’épandage de 36 m). La fertilisation organique pourrait être davantage mobilisée et des changements dans les assolements pourraient être opérés (espèces plus économes en azote).
Les agriculteurs devront donc, comme lors de la campagne précédente, arbitrer en fonction de leur optimum technico-économique.