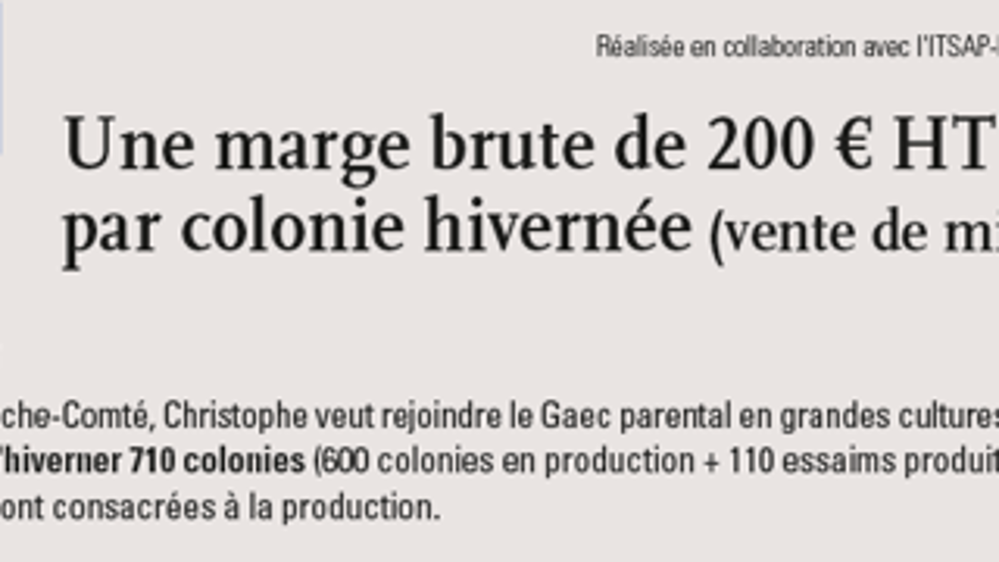Règles à connaître
Devenir professionnel
« La distinction entre professionnel et amateur se fait à partir du nombre de ruches », explique Constance Beri, chargée de mission à l’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation (Itsap). La surface minimale d’assujettissement est fixée à 200 ruches. En dessous, l’apiculteur doit justifier d’au moins 1 200 heures de travail par an incluant l'élevage et les activités de prolongement pour bénéficier du statut de chef d’exploitation.
Déclarer ses ruches
Les détenteurs de ruches doivent se déclarer lors de leur installation, dès la première colonie détenue. Les nouveaux obtiennent alors leur numéro d’apiculteur (NAPI). Cette déclaration doit ensuite être réalisée annuellement entre le 1er septembre et le 31 décembre en ligne. « Elle permet de préciser le nombre de ruches et l’emplacement des ruchers », indique Constance Beri.
Suivi et traçabilité
Le registre d’élevage illustre le suivi sanitaire des colonies d’abeilles, il doit notamment contenir la liste des interventions effectuées sur le rucher. Le cahier de miellerie permet de garantir la traçabilité des produits de la ruche. « Ce document est indispensable pour les productions sous signe de qualité, souligne l’experte. Les organismes certificateurs vont le vérifier lors du contrôle. »
Définir l'emplacement des ruches
Le code rural prévoit que chaque département définisse les règles d’emplacement des ruches. « Par exemple, dans l’Ain, il est interdit d’en implanter à moins de 50 m d’immeubles habités », indique Constance Beri.
Accord sur les pratiques
Sans foncier dont il est propriétaire ou fermier, l’apiculteur doit prospecter pour trouver l’emplacement où positionner ses ruches. « Rien n’oblige l’agriculteur en place de modifier ses pratiques une fois que l’apiculteur a positionné ses ruches, signale l’experte. Néanmoins, une entente préalable entre l’un et l’autre peut être trouvée en amont. Les ruches peuvent être retirées au cours de la pollinisation si l’arboriculteur qui prête ses terres décide de traiter son verger. »
Points à anticiper
Charge de travail
En apiculture, la charge de travail se concentre sur la période de production, de mars à septembre, rythmée par les transhumances et les récoltes. En fin de saison, l'apiculteur procède au traitement contre le varroa et peut compléter les réserves des colonies pour l’hiver. La commercialisation du miel en vrac se fait pendant l’hivernage des colonies, de novembre à février. La vente en vrac permet de limiter le temps passé sur la commercialisation. Néanmoins, dans ce cas, les prix de vente du miel sont conditionnés par le marché mondial.
Des investissements
Un bâtiment est nécessaire pour l’extraction et le stockage du miel. L’humidité et la température doivent y être contrôlées pour assurer la bonne qualité du produit. Le matériel de ruche, de transport et de manutention doit être rajouté aux investissements.
Des aides existent
Les apiculteurs peuvent prétendre aux MAE apicoles sous conditions. FranceAgriMer propose l’aide au repeuplement et au développement du cheptel. Destinée aux apiculteurs affiliés à la MSA et possédant plus de 50 colonies, cette aide prend en charge une partie des coûts d’achat d’essaims et du matériel de ruche. Elle est plafonnée à 5 000 € par exploitation ou associé de Gaec. FranceAgriMer propose également l’aide à la transhumance pour réduire la pénibilité du travail, avec une prise en charge partielle (40 % maximum du montant total) des outils de transhumance (chargeurs, camions, grue…). Enfin, certaines aides régionales peuvent être sollicitées, sous conditions, par les apiculteurs pour subventionner une partie des ateliers de transformation.