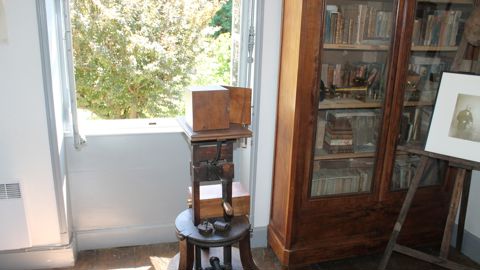Au printemps, l’arrivée des beaux jours sonne l’heure de la sortie pour les 47 vaches du Gaec du Maroly, après plus de six mois à l’attache. « Fin avril, elles commencent à sortir, puis autour du 20 mai, elles montent en alpage, entre 1 600 et 1 800 m, où elles restent jusqu’à la mi-octobre », présente Arnaud Missillier, installé avec son père et sa compagne au Grand-Bornand, en Haute-Savoie, à 1 000 m d’altitude.
L’abondance est une bonne marcheuse
« L’été, toute la famille vit à l’alpage, où tout est dupliqué : l’étable, l’habitation, l’atelier de transformation… On y travaille de la même manière, toutefois les vaches sont dehors toute la journée, et parfois la nuit. Elles rentrent pour la traite. Là-haut, elles marchent facilement 1 h 30 par jour. » C’est l’un des motifs qui a conduit au choix de la race abondance, parmi les trois acceptées par le cahier des charges de l’AOP Reblochon. « En plus d’être plus productive que la tarine et plus rustique que la montbéliarde, l’abondance est une bonne marcheuse ! » Un choix de raison mais aussi de passion pour son père, Philippe Missillier, qui préside depuis janvier l’OS Races alpines réunies (1).

Comme quelque 35 autres élevages de la commune, le Gaec fabrique du reblochon fermier. « Au village, il n’y a pas de laiterie : il y a des grossistes à qui on vend des produits finis, et des affineurs pour des fromages semi-affinés », explique Arnaud. Le Gaec commercialise la moitié de sa production sous forme de reblochons affinés via les restaurants, magasins de station et centres de vacances. Le reste part à huit ou dix jours d’affinage chez Pochat (Lactalis), un débouché offrant plus de souplesse sur les volumes. Et pour mieux lisser les ventes, 20 à 25 % du lait sont transformés en tomes et raclette fermières, à l’affinage plus long.
Saisonnalité
Car le reblochon présente une saisonnalité problématique. « La demande est très forte entre décembre et février, mais elle plonge entre avril et juin, au moment où les vaches produisent le plus, souligne Arnaud. Et il est impossible de jouer sur le stockage : le reblochon est affiné en vingt et un jours et doit être vendu sous un mois et demi. » C’est pourquoi un écrêtement de la production est imposé aux producteurs : chacun peut transformer au maximum 22 % de son quota de reblochon sur avril, mai et juin. Pour le Gaec, le quota annuel s’élève à 24 500 kg. Soit près de 50 000 reblochons, et autant de pastilles vertes pour en assurer la traçabilité.

L’histoire de ce fromage, qui remonte au XIIIe siècle, le jeune éleveur la connaît bien : « Pour payer moins d’impôts, basés sur leur production, les fermiers finissaient la traite après le départ du contrôleur. Cette traite cachée était appelée rebloche. » Il la raconte volontiers aux vacanciers qui, l’hiver, font bondir la population du village de 2 000 à 20 000 habitants. Lors de visites organisées avec l’office du tourisme, le Gaec ouvre ses portes et répond aux interrogations sur l’attache des vaches.
Des coûts élevés
Aux questions de bien-être animal s’ajoutent des considérations économiques, alors que la place et la paille sont rares. C’est d’ailleurs ce qui pousse les associés à déléguer l’élevage des génisses. Autour du site hivernal, l’exploitation compte 6 ha très pentus. « Un tiers seulement de notre surface est mécanisable, et uniquement en alpage, indique Arnaud. Même avec du matériel spécifique, qui coûte 150 000 €, on ne pourrait faucher que 15 % supplémentaires ! » Le Gaec ne produit qu’un quart de son foin et achète 100 % de sa paille et de ses céréales.
« L’agriculture de montagne coûte cher », résume l’éleveur. Au point que des inquiétudes planent sur le maintien des volumes de reblochon fermier. « Il y a de moins en moins de main-d’œuvre, et les exploitations sont globalement arrivées au maximum de leur agrandissement, vu l’investissement que cela implique. Un bâtiment nécessite des travaux de terrassement et une charpente supportant 1,5 m de neige. Il doit être adossé à un atelier de transformation car il n’y a pas de collecte de lait ici. Au total, une place en bâtiment revient environ à 20 000 € ! Et avec l’alpage, on double l’investissement… »B. Lafeuille
(1) Organisme de sélection des races abondance, villarde et hérens.