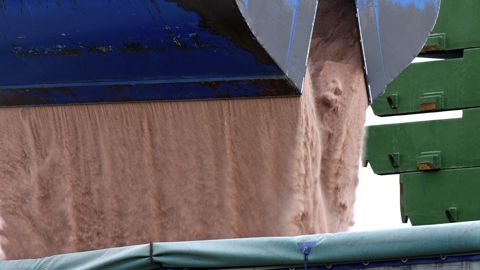« On préfère voir la plaine comme elle est actuellement que l’an dernier à la même époque », lance d’emblée une conseillère de l’Yonne. Et pour cause : après deux années avec des automnes et hivers doux et relativement humides, favorables à de très fortes croissances en début de cycle, la campagne de 2017 retrouve des conditions de températures « normales », pour l’instant.
Bon état végétatif
Le développement des céréales suit donc cette année un rythme plus habituel. Leur état est globalement très satisfaisant en cette sortie d’hiver, avec des stades proches des normales, voire en deçà. Les implantations se sont déroulées dans de bonnes conditions et aucun dégât majeur n’a été enregistré lors de l’épisode de gel de janvier.
En moyenne, les premières parcelles semées sont entre le début et la fin du tallage. « L’an dernier à la même époque, certaines étaient déjà en redressement », indique un responsable agronomique dans le Loiret qui se dit « plus serein ». Les céréales implantées tardivement atteignent, en revanche, à peine le stade des 3 feuilles. « Nous sommes en retard de quinze jours par rapport à la moyenne, et même d’un mois comparé à 2016, note un opérateur en Lorraine. Il n’y a pas eu assez d’eau pour assurer une bonne levée dans les sols argileux. » Même constat en Île-de-France et dans le Centre. Dans l’Allier, le retard atteint une dizaine de jours comparé à la normale.
L’état sanitaire des parcelles est plutôt correct actuellement. Les maladies sont encore peu présentes (voir l’encadré ci-dessous). Le froid est arrivé assez vite et a calmé le jeu pour les pucerons, ce qui devrait ainsi limiter l’apparition de JNO (jaunisse nanisante de l’orge) contrairement à 2016. Des problèmes de taupins ont été repérés en Vendée tandis que les limaces ont abîmé des parcelles dans l’Yonne, l’Ille-et-Vilaine ainsi que le Loiret. « Quand il y a un redoux, on voit qu’elles reprennent leur activité, ce qui peut être encore préjudiciable pour les parcelles les moins avancées ! » souligne un technicien en Bourgogne.
Des côté des mauvaises herbes, la situation est disparate. Là où des herbicides ont été appliqués à l’automne, la situation est correcte. Les traitements ont plutôt bien fonctionné à la faveur d’un temps favorable. Les désherbages de rattrapage ont déjà débuté ou vont démarrer. Le salissement est important, voire irrécupérable, en rotation courte lorsqu’aucun passage n’a été réalisé à l’automne.
Au-dessus des valeurs habituelles
Le plus atypique cette année, pour le moment, ce sont les valeurs très élevées des reliquats azotés dans les parcelles à précédent paille. C’est moins vrai derrière betteraves. Il s’agit d’une conséquence des mauvais rendements en 2016 des céréales qui n’ont pas absorbé l’azote apporté pour un potentiel bien supérieur. Et « depuis le début de l’automne, le lessivage de l’azote minéral présent dans le sol, qu’il provienne du reliquat du précédent ou de la minéralisation de la matière organique, est quasi nul y compris dans les sols les plus superficiels », précise Arvalis. La faible pluviométrie hivernale explique donc aussi cette situation.
Les stocks actuels d’azote dans le sol sont souvent plus élevés que d’habitude et généralement suffisants pour couvrir les faibles besoins des cultures dans les prochaines semaines. Par exemple, derrière céréales, les reliquats se situent le plus souvent au-delà des 60 unités pour les deux premiers horizons. Ils peuvent même monter jusqu’à 100 unités, derrière blé en terres argileuses. C’est deux à trois fois plus que d’habitude. « Je n’ai jamais vu ça depuis vingt ans », s’exclame un opérateur dans le Centre. Tandis qu’un autre en Champagne-Ardenne n’hésite pas à dire que « les blés sont verts comme des poireaux et n’ont pas faim d’azote ! »
Il n’est pas nécessaire de se presser pour épandre l’engrais. Les opérateurs incitent à réaliser des reliquats s’ils n’ont pas été déjà faits, afin de bien piloter ensuite les apports, notamment sur les cultures de printemps. « Pour certaines parcelles, dans le calcul du bilan, la dose totale est faible, il faudra donc faire attention à bien la répartir au printemps, ni trop tôt ni trop fort », fait part un opérateur de l’est de la France.
Colzas hétérogènes
Le redoux de ces derniers jours engendre les premiers signes de reprise de végétation des colzas les mieux implantés, qui sont à 1-1,5 kg/m² de biomasse, voire plus. Mais les conditions automnales n’ont pas toujours pu compenser la faible croissance des colzas à levées tardives et hétérogènes. Beaucoup de semis se sont faits dans le sec. Et les biomasses fraîches ne dépassent pas parfois les 300-400 g/m². Des parcelles ont dû être retournées ou sont en passe de l’être. Si bien qu’Agreste a annoncé une baisse de 7 % des surfaces au niveau national. Le recul serait encore plus important dans le Nord-Est.
Les grosses altises ont été relativement discrètes, le froid a ralenti le cycle des larves. Toutefois, les températures plus douces actuelles sont favorables à la reprise d’activité des charançons de la tige. La sortie des cuvettes jaunes est donc d’actualité ! La campagne de 2017 s’annonce donc sous de meilleurs auspices que l’an dernier, en tout cas pour l’instant. Le manque de pluies commence toutefois à inquiéter pour les cultures en place et les semis de printemps (voir l’encadré ci-dessous). S’il ne pleut pas régulièrement ce printemps, la situation sera difficile, notamment dans les sables et les sols argilo-calcaires.