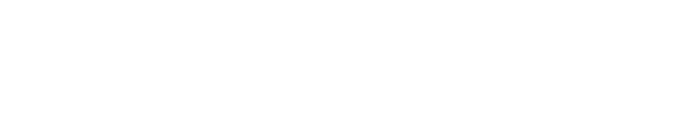Du diagnostic à la première indemnisation, c’est un parcours administratif semé d’embûches qui attend les victimes de maladie professionnelle liées aux produits phytosanitaires. La première difficulté relève de la méconnaissance du FIVP, le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, et des droits qui y sont attribués.
« Certains estiment qu’ils ne méritent pas leur indemnisation parce qu’ils ne l’ont pas gagnée à la sueur de leur front, alors qu’en réalité, c’est à la sueur de leur travail qu’ils sont devenus malades. » Depuis 2016, Claire Bourasseau, la responsable du service victimes du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP), accompagne les victimes de maladies professionnelles en lien avec les produits phytosanitaires. Elle constate de nombreuses difficultés dans leur démarche, de l’acceptation de la maladie à la procédure administrative et médicale.https://www.dailymotion.com/video/x98812oEn 2023, 671 dossiers ont été enregistrés par le fonds pour des reconnaissances de maladie professionnelle comme Parkinson ou des cancers du sang, de la vessie et de la prostate. Jean-Noël Jouzel, sociologue au CNRS (1), travaille depuis une dizaine année sur le sujet. S’il n’existe pas de données officielles, il estime qu’il y a aujourd’hui « un non-recours massif » au FIVP, faute de communication suffisante sur la reconnaissance des maladies professionnelles dans le monde agricole.Créé en 2020, le fonds harmonise et simplifie les demandes sur le territoire français. Ces dossiers étaient autrefois traités par les caisses locales de la Mutualité sociale agricole (MSA). Cette centralisation permet « une équité plus importante » avec le régime des salariés, se réjouit Christine Dechesne-Céard, responsable du FIVP.Depuis, les agriculteurs perçoivent, en plus de l’indemnité versée au titre de l’assurance maladie, un complément d’indemnisation du FIVP. Ce dernier correspond à un tiers de leur rente totale. Et les cotisants solidaires sont désormais plus nombreux à pouvoir percevoir une indemnisation à la suite d’un assouplissement des conditions de reconnaissance.Le FIVP, petite révolutionGrâce à l’équipe restreinte du FIVP, « il y a un traitement beaucoup plus humain des dossiers », constate Claire Bourasseau qui se réjouit de pouvoir enfin accéder à des données unifiées sur un sujet encore largement inconnu du grand public. L'association Phyto-Victimes intervient dans les écoles, auprès de futurs agriculteurs, pour sensibiliser les jeunes sur les risques des produits phytos. (© Johanne Mâlin / GFA) Car le FIVP est le fruit d’une longue évolution dans le processus de reconnaissance des victimes de maladies liées à l’utilisation des produits phytosanitaires. En 2012, Parkinson est la première maladie à être reconnue d’origine professionnelle en lien avec les pesticides avant d’être notamment suivie par le lymphome non-hodgkinien (2015), le myélome multiple et la leucémie lymphoïde chronique (2019), puis le cancer de la prostate (2021).« Personne ne m’a dit »Aujourd’hui, quelques maladies sont directement reconnues d’origine professionnelle dans les tableaux de l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité). Ils précisent les travaux susceptibles de provoquer la maladie et les délais de prise en charge. Mais de nombreuses difficultés entravent le parcours médical et administratif des victimes, principalement agriculteurs. Neuf demandes sur dix sont issues du monde agricole en 2023.Pour Jean-Noël Giraud, ancien éleveur en Vendée, diagnostiqué d’un myélome multiple, « personne ne [lui avait] dit qu’on pouvait faire reconnaître [sa] maladie », raconte-t-il. Après avoir découvert l’association Phyto-Victimes, qu’il contacte pour faire de la sensibilisation, il entame finalement son parcours administratif. Jean-Noël Giraud a découvert dans un journal l'association Phyto-Victimes.C'est à cette occasion qu'il a commencé les démarches, après avoir réfléchi pendant plusieurs mois. (© Johanne Mâlin/GFA) L’ignorance actuelle des médecins s’accompagne de la méconnaissance du monde agricole sur les risques des produits phytosanitaires utilisés les dernières décennies. « Quand on traitait les animaux contre les mouches, les vers… On ne prenait jamais de gants, se remémore l’ancien éleveur. Les pesticides, on pense surtout aux produits dans les champs, mais il y a aussi ceux qu’on met sur les animaux ». Les systèmes de polyculture-élevage sont pourtant en tête des secteurs dont sont issues les victimes avec un quart des demandes auprès du FIVP en 2023.Une procédure complexeQuand les agriculteurs découvrent que leur maladie peut être reconnue, parfois plusieurs années après leur diagnostic, l’étape de la procédure administrative peut donner du fil à retordre. L’association Phyto-Victimes a recensé pas moins de 14 étapes pour déposer un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle et demander une indemnisation.« Il faut être accompagné : une procédure de maladie professionnelle, c’est une fois dans la vie, si c’est refusé et qu’on ne conteste pas la décision, c’est terminé », avertit Claire Bourasseau qui vient parfois à la rescousse d’agriculteurs perdus dans leur dossier. Entre trouver le bon certificat médical, remplir le formulaire Cerfa correspondant, ou préparer les rendez-vous avec les médecins du travail… Les erreurs peuvent vite s’accumuler et engendrer un refus.Des tableaux de maladie incompletsSi certaines pathologies donnent directement droit à une indemnisation, d’autres maladies peuvent être reconnues au cas par cas. En 2023, un cancer du sein, trois de la vessie et un du poumon, ont, parmi d’autres pathologies, été reconnues d’origine professionnelle.Mais pour justifier de son exposition, il faut fournir les factures des produits utilisés sur la ferme durant sa carrière. Un travail de titan auquel a dû se confronter Antoine Lambert, président de l’association Phyto-Victimes depuis 2020. Antoine Lambert est président de Phyto-Victimes depuis 2020.Un an après, il a été diagnostiqué d'un cancer du sang. (© Johanne Mâlin/GFA) Atteint d’un cancer du sang lié à l’exposition au benzène, son dossier a été refusé par le fonds. Pourtant, sa maladie est bien reconnue d’origine professionnelle par l’État. Le motif du refus ? L’agriculteur n’a pas pu être exposé au benzène, puisque son utilisation est extrêmement restreinte depuis 1990, soit quatre ans avant le début de sa carrière.Justifier son exposition« La théorie disait que ce n’était pas possible que je sois reconnu parce que ce n’était pas possible que je sois exposé », résume Antoine Lambert, qui se replonge dans sa comptabilité pour fournir les factures des produits utilisés « de l’année de [sa] pathologie jusqu’à [son] installation ».Grâce à des analyses de pesticides réalisées par un agriculteur dans le cadre d’une procédure judiciaire en 2006, Antoine a pu prouver qu’il avait bien été exposé à des produits contenant du benzène, même après l’interdiction de cet actif. Il a fait appel de la décision de refus, et a obtenu gain de cause. Il est désormais devant la justice pour contester son taux d’incapacité déterminé par le FIVP, qu’il estime inférieur à son état physique actuel.Si les agriculteurs peuvent retourner dans leurs archives, il est beaucoup plus difficile d’accéder à la liste des produits utilisés lorsque la victime est salariée, comme Maurice Baudouin, atteint d’un cancer de la prostate.Des droits ignorésPourtant, la reconnaissance, qui ouvre droit à une indemnisation parfois élevée, permet aussi d’accéder à d’autres droits. Mais même lorsque les victimes ont enclenché la procédure, ils leur restent largement inconnus. Phyto-Victimes, qui les a découverts au fur et à mesure des dossiers accompagnés prend soin d’en informer les malades, en l’absence de communication claire du fonds.Par exemple, Maurice Baudouin est parti à la retraite à soixante ans, car son taux d’incapacité est supérieur à 20 %. Comme d’autres, il l’a découvert après la reconnaissance de sa maladie par le fonds, grâce à Phyto-Victimes. L'épouse de Maurice Baudouin a découvert par hasard qu'il pouvait être reconnu en maladie professionnelle. (© Johanne Mâlin/GFA) Sur le plan fiscal, les agriculteurs avec un taux d’incapacité supérieur à 40 %, bénéficient d’une demi-part d’imposition supplémentaire. Majoritairement issue de leurs cotisations sociales, l’indemnisation des agriculteurs est censée être exonérée d’impôt au même titre que les salariés. Une information confirmée par le ministère de l’Économie et le site internet de l’administration française.Or, la rente figurait bien sur les fiches d’imposition en mai dernier. Interrogée par la France agricole, la MSA avait alors demandé à Bercy une évolution pour « mettre fin au prélèvement » mais cet été, la MSA dit être « encore en attente » des instructions du ministère de l’Économie.« On doit vraiment se battre »Lorsque la victime décède des suites de sa maladie, ses ayants droit peuvent entamer ou continuer la procédure de reconnaissance. Dans ce cas, ils percevront une réversion de la rente et pourront obtenir une participation aux frais d’obsèques, comme Danièle Godefroy, dont le mari agriculteur est décédé d’un cancer. « Il est très rare que l’information vienne des caisses [locales de MSA] elles-mêmes. On doit vraiment se battre », déplore Claire Bourasseau. Danièle Godefroy a dû se replonger dans ses papiers dix-sept ans après la première demande de son mari pour faire reconnaître sa pathologie en maladie professionnelle. (© Florian Salesse) L’association milite aussi pour que les agriculteurs reconnus avant la création du FIVP, environ 630 d’après la MSA, soient informés du complément d’indemnisation qu’ils pourraient percevoir. D’après le FIVP, ces victimes « ont toutes été appelées individuellement au moment de la création du fonds pour faire valoir leur droit ». Une information que La France agricole n’a pas pu vérifier, et démentie par Phyto-Victimes.La dernière victime ayant réclamé le complément d’indemnisation en juin dernier n’avait jamais été mise au courant de ce complément avant de s’enregistrer auprès de Phyto-victimes, précise l’association. Ensemble, ces droits peuvent pourtant représenter beaucoup pour des agriculteurs qui doivent parfois gérer leur exploitation tout en étant malade.Pour Jean-Noël Jouzel, sociologue au CNRS, le monde agricole, « c’est une population qui ne se plaint pas […] il y a un non-recours qui est massif ». Le sentiment de culpabilité des exploitants peut aussi être un frein à recourir au FIVP. Pourtant, quand « l’outil de travail s’inscrit dans une lignée familiale, il est impératif de maintenir à flot son exploitation, ce qui peut conduire à mettre sa santé au second plan. Souvent les épouses convainquent les conjoints qu’obtenir une rente permet au moins de faire tourner l’exploitation ».Manque de communicationLe FIVP justifie la méconnaissance des droits par la création récente du fonds. « On ne peut que souhaiter que son existence soit davantage connue », assure Christine Dechesne-Céard, pilote du fonds, qui « entend utiliser davantage le site internet à l’attention du grand public ». Des actions de communication seraient également prévues « à l’attention des professionnels de santé ». (© Johanne Mlin / GFA) (© Johanne Mlin/GFA) « Aujourd’hui il y a peu de communication et c’est entièrement de la responsabilité du fonds et des pouvoirs publics, constate Claire Bourasseau. Si on veut faire de la communication, on peut en faire. Avec le Covid-19, il y a eu de la communication matin, midi et soir parce que c’était un enjeu de santé publique. Mais les pesticides, c’est aussi un enjeu de santé publique. »Régulièrement interrogée par des médias et organisations à l’étranger, Phyto-Victimes se veut optimiste : « Nous sommes regardés par d’autres pays. Ce qui a été fait en France [avec le FIVP], on peut en être fiers. » Pour en être fier, il faut le dire haut et fort. Ce qui est encore loin d’être le cas aujourd’hui.(1) Centre national de la recherche scientifique.ContactsPour toute interrogation, le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) propose un numéro vert gratuit, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00 : : 0 800 08 43 26 ;L’association Phyto-victimes est joignable par téléphone au 06 74 78 88 27 ou en envoyant un mail à contact@phyto-victimes.fr