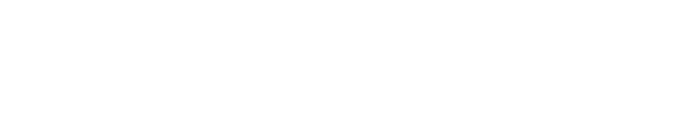Comment a évolué la reconnaissance des maladies professionnelles en lien avec les pesticides dans le monde agricole ?
Les premières études épidémiologiques qui montrent que l’exposition professionnelle aux pesticides en agriculture augmente le risque de la maladie de Parkinson et des cancers du sang, ont été publiées dans les années quatre-vingt-dix. En 2012, l’agriculteur Paul François, victime d’une intoxication avec un herbicide, gagne en première instance contre l’entreprise Monsanto. Cette victoire spectaculaire d’un agriculteur fut une énorme caisse de résonance.
2012 est aussi l’année de la création du tableau de reconnaissance de maladies professionnelle spécifique à Parkinson. L’année suivante, l’expertise collective de l’Inserm, qui compile la littérature existante, permet d’être affirmatif : il y a une présomption de lien fort entre les trois maladies (cancer du sang, de la prostate et Parkinson) et les produits phytosanitaires. Sur le plan de la justice, de la science et du droit, ces trois évènements attestent désormais d’une réalité.
Quelles étaient les principales difficultés que rencontraient les agriculteurs victimes ?
Dans les années 2010, la première difficulté était de faire le lien entre la maladie et l’exposition. Les médecins n’étaient pas forcément formés sur les facteurs de risques. La deuxième difficulté était de lancer la procédure. Ce n’était pas automatique pour un malade de se considérer comme une victime qui a subi un préjudice.

Souvent, les agriculteurs s’imputaient à eux-mêmes la responsabilité de leur malheur. Cela tient à la prépondérance, dans les politiques publiques de prévention des risques, d’injonction à porter des vêtements de protection dont l’efficacité est sujette à caution. Il y a aussi des freins liés à la procédure : il faut garder des traces de son exposition. Pour les salariés et les saisonniers, ce n’est pas simple.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Ces difficultés sont atténuées par la création de tableaux de maladies professionnelles qui rendent le parcours plus simple. Cela n’empêche pas qu’il y a toujours beaucoup d’ignorance dans le corps médical, sur la science et sur le droit de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le prisme de la culpabilisation reste fort. Le discours public autour des pesticides s’est densifié. Et dans cette critique environnementaliste, les agriculteurs sont plutôt en position d’accusés que de victimes. Tout cela fait que ce n’est pas évident de se sentir légitime en tant que victime.
Qu’a changé la création du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) ?
Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) reconnaît de manière officielle que les pesticides ont fait des victimes. Il a une portée symbolique réelle, mais sa portée matérielle est limitée. C’est principalement une simplification de dispositifs déjà existants. Il y a un alignement des prestations des exploitants sur celles des salariés grâce à un complément d’indemnisation par le FIVP.
En comparaison avec le FIVA (fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante), le FIVP est moins généreux et maintien le principe d’une indemnisation forfaitaire, mais donc partielle. Ce que reprochent les victimes à ce fonds, c’est de ne pas reconnaître la responsabilité de l’État dans les dégâts causés par les pesticides sur la santé des agriculteurs.
Le fonds est largement financé par les cotisations patronales des agriculteurs eux-mêmes. Il reste aussi restreint aux professionnels qui utilisent les pesticides. En revanche, il crée un droit totalement inédit en France : la possibilité de faire reconnaître des pathologies affectant les enfants du fait de l’exposition professionnelle de leurs parents.