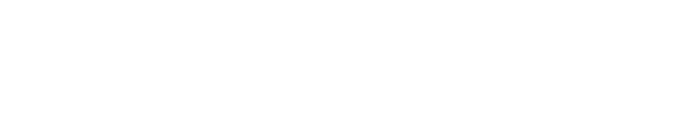En 2020, le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) a instauré un droit inédit : la possibilité pour les enfants malades exposés de manière prénatale aux produits phytosanitaires, d’obtenir reconnaissance. Seulement 22 demandes de reconnaissances ont été déposées depuis 4 ans.
« Un droit inédit mais pour l’instant il y a un non-recours massif. » Voilà comment Jean-Noël Jouzel, sociologue et directeur de recherche au CNRS (centre national de la recherche scientifique) sur la santé environnementale, décrit la procédure de reconnaissance pour les enfants victimes des produits phytosanitaires du fait d’une exposition prénatale.C’est une première dans le processus de reconnaissance des maladies professionnelles. Créé en 2020, le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) reconnaît que les enfants peuvent eux aussi être victimes de maladies en lien avec l’exposition de leurs parents aux produits phytosanitaires.Aujourd’hui, cinq pathologies sont reconnues par le FIVP : Les leucémies ; Les tumeurs cérébrales ; Les troubles de neurodéveloppement (autisme, déficience intellectuelle) ; La fente labio-palatine ; L’hypospadias (malformation de la verge).Le fonds justifie la prise en charge des enfants par une exposition aux pesticides « prénatale », soit maximum six mois avant la date de conception du fœtus par l’intermédiaire de ses deux parents biologiques, la mère ou le père, qui seraient exposés dans le cadre de leur travail aux produits phytosanitaires.« Balbutiements »« La commission des enfants [du FIVP] n’en est encore qu’à ses balbutiements », estime le chercheur. En 2023, seulement trois dossiers de « demandeurs-enfants » ont reçu une décision favorable de la part du FIVP pour des pathologies reconnues. Jean-Noël Jouzel enquête sur les enfants touchés par des maladies résultant d'une exposition professionnelle in-utero. (© Cédric Faimali/GFA) « La liste des pathologies n’est pas pour autant limitative et la CIEVEPP (la commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale) peut avoir à rechercher le lien entre l’exposition prénatale de l’enfant et toute autre pathologie qu’il aurait déclarée », précise le FIVP dans son rapport d’activité 2023.Financement via la taxe sur les produits phytosMais cette ouverture se heurte à la réalité. Sur les 22 demandes déposées à ce titre, 16 n’ont pas été instruites faute de dossiers complets. Une plaie pour la responsable du service d’aide aux victimes de l’association Phyto-victimes, Claire Bourasseau : « C’est important qu’il y ait un accompagnement. La procédure est complexe, d’autant plus pour des gens seuls avec un enfant malade. »Malgré tout, l’année 2023 maintient un espoir pour la reconnaissance de l’exposition prénatale. En un an, c’est la moitié du total des demandes depuis la création du fonds (2020) qui a été déposée, signe que la sensibilisation fonctionne doucement.L’indemnisation des enfants, « beaucoup plus importante » que celles des adultes, d’après Claire Bourasseau, est financée « au titre de la solidarité nationale », précise le fonds. Plus concrètement, c’est la taxe sur les produits phytopharmaceutiques qui finance leur indemnisation. Ainsi, « tous les enfants peuvent bénéficier d’une indemnisation du FIVP sans distinction du régime de protection sociale d’affiliation de leurs parents », ajoute l’institution.DémarchesPour déposer une demande, les familles doivent se tourner vers le FIVP, qui centralise toutes les démarches au niveau national. Un cerfa est disponible sur le site à remplir dans les 10 ans de l’état de consolidation de la maladie (moment à partir duquel la maladie est stabilisée). Le fonds dispose d’un délai de six mois pour étudier la demande et se prononcer. Si celle-ci est acceptée, il propose une indemnisation aux victimes et à leur famille. Les enfants peuvent aussi être victimes de maladie en lien avec l'exposition aux produits phytosanitaires. (© C. Fricotté/GFA) Comment prouver l’exposition prénatale de l’enfant ? « C’est un travail de titan », reconnaît Claire Bourasseau qui a déjà accompagné une poignée de familles. Pour réaliser un état des lieux de l’exposition des parents, « nous nous concentrons sur les produits utilisés pendant la grossesse ou six mois avant la date de conception ».GénérationsLes mineurs et leur famille ne sont pas les seuls à pouvoir déposer un dossier. Bien au contraire. Sur la période 2021-2023, « un quart seulement de l’ensemble des demandeurs-enfants a moins de 18 ans », note le FIVP. Les personnes de 40 à 55 ans sont les plus nombreuses à présenter un dossier sur leur exposition aux pesticides pendant la période prénatale.Le dépôt de la demande, désormais limité à dix ans après la date de consolidation de la maladie devrait voir baisser la moyenne d’âge de ces « demandeurs-enfants » dans les prochaines années.Alors que les maladies liées aux pesticides des professionnels commencent à être acceptées dans le monde agricole, les démarches pour faire reconnaître un enfant restent taboues. « C’est déjà compliqué de parler de la maladie professionnelle. Mais se dire que le métier qu’on aime a rendu son enfant malade, il faut pouvoir porter cette culpabilité », témoigne Claire Bourasseau.