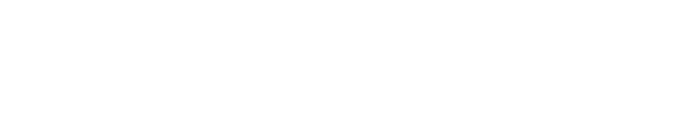En 2023, près d’un tiers des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle en lien avec les pesticides est issu de salariés. Un chiffre en hausse, puisqu’en 2022 elles représentaient seulement un quart des demandes. Dans ce cadre, quel rôle l’employeur doit assumer ? Que risque-t-il ?
Des informations à fournir
Pour chaque dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) mène une enquête administrative et médicale. Lorsque la demande émane d’un(e) salarié(e), le fonds envoie un questionnaire à l’employeur sur l’environnement professionnel du salarié.

Dans ce cadre, l’employeur doit aussi fournir les informations concernant les produits phytosanitaires utilisés par son salarié. L’obligation n’est pas légale, mais s’il y a un désaccord qui arrive sur le terrain judiciaire, « les juges ont le pouvoir d’instruction et nous avons la possibilité de délivrer une sommation de communiquer les produits utilisés », explique François Lafforgue, avocat au barreau de Paris qui accompagne les victimes de produits phytos au tribunal. « Mais cela ne nous est pas encore arrivé », tempère l’avocat qui est « toujours parvenu à obtenir les éléments ».
Cotisations sociales
Si le salarié est reconnu en maladie professionnelle, l’employeur sera notifié de la décision par courrier. Ce n’est pas à lui de payer l’indemnisation. Elle sera versée par la MSA (Mutualité sociale agricole). « Le seul risque pour l’employeur est de voir augmenter ses cotisations maladie professionnelle mais ce ne sont pas des montants énormes », veut rassurer Claire Bourasseau, responsable du service d’aide aux victimes de l’association Phyto-victimes.

Par ailleurs, cette augmentation ne serait pas appliquée seulement à l’agriculteur employeur du salarié malade. Dans le cas de petites entreprises, les cotisations sociales des employeurs sont « solidaires » par filière, explique-t-on du côté du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP). Il faudrait donc avoir une hausse conséquente du nombre de salariés agricoles malades pour observer une augmentation de ces cotisations patronales. Cette question reste pour l’instant hypothétique, au vu du peu de cas de maladies professionnelles de salariés agricoles déclarés.
« Faute inexcusable de l’employeur »
Un salarié peut également décider d’aller en justice. Dans ce cas, il pourra faire valoir la « faute inexcusable de l’employeur » s’il estime n’avoir pas été protégé par son employeur contre l’exposition aux produits. Cela peut arriver lorsqu’il n’y a pas d’équipement de protection ou qu’ils sont défaillants.
Un cas rare, selon Claire Bourasseau, expliqué par un rapport « plus familial » dans le secteur agricole entre les patrons et les salariés qu’en industrie. « La plupart du temps le patron effectue les mêmes tâches que le salarié », ajoute la responsable.
En 2023, seule une demande auprès du FIVP a suscité également un recours judiciaire pour « faute inexcusable de l’employeur » d’après leur rapport d’activité 2023. La faute inexcusable, si elle est reconnue par la justice, peut avoir de véritables répercussions pour l’employeur : « Dans ce cas, il est possible que l’assurance maladie demande un remboursement des sommes versées au salarié », précise Christine Dechèsne-Céard, responsable du FIVP.
Protéger
Si la « meilleure des protections reste de faire sans [les produits] » pour éviter l’exposition, Claire Bourasseau mesure la difficulté pour certaines cultures de se passer de produits phytosanitaires. Dans ce cas, il s’agit « d’éviter les produits les plus dangereux : ceux qui sont reconnus cancérogènes et perturbateurs endocriniens pour essayer de trouver des produits de substitution ». Enfin, il faut « avoir du matériel adapté et révisé régulièrement » et « utiliser les équipements de protection pour se protéger au maximum ».

Une procédure confirmée par David Mussard, médecin-conseiller technique national ou sein de la DSST (Direction de la Sécurité et de la Santé au Travail) en charge du risque chimique. « Le meilleur moyen de se prémunir d’effets indésirables, c’est d’avoir une protection à disposition. Rares sont les gens qui cherchent à se mettre en danger sciemment. C’est plus souvent plutôt par négligence ou méconnaissance. »