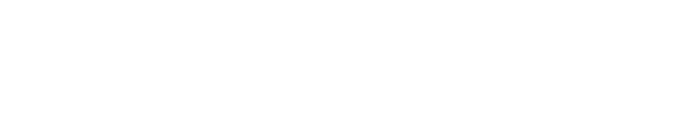S’intégrer dans le monde agricole sans en être issu n’est pas toujours aisé. En plus du difficile accès à la terre, il faut apprendre les codes, s’insérer mais aussi prouver sa valeur. Comment se déroule le parcours d’installation des non-issus du milieu agricole ?
L’agriculture fait face à un déficit important de ressources humaines côté salariés mais surtout concernant les chefs d’exploitation. En cinquante ans, leur nombre a baissé de 71 %, de 35 % en vingt ans et de près de 18 % durant la dernière décennie, pour atteindre 496 400 exploitants et coexploitants en 2020 (1).Dans les cinq ans à venir, la ferme France devra faire face au départ potentiel de la moitié de ses chefs d’exploitation. Avec 30 % des agriculteurs âgés de plus de 55 ans sans successeur désigné, la question de la reprise devient préoccupante. Face à ce constat, le renouvellement des générations est devenu un enjeu majeur, avec la nécessité d’attirer et de trouver des candidats.Un vivier de futurs installésPour pallier ce manque de main-d’œuvre et accompagner le renouvellement des générations, il convient donc de chercher des profils qui ne sont pas forcément enfants d’agriculteurs. Autrement dit, des non-issus du milieu agricole (Nima), ou nouveaux actifs agricoles comme préférait les appeler un rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) de 2023.Ces nouveaux actifs s’intéressent aux métiers de l’agriculture, plus particulièrement à celui de chef d’exploitation, puisqu’ils représentent plus de la moitié de la population qui s’informe auprès des points accueil installation (1). Ces postulants montrent une large diversité de profils et d’aspirations mais ont la caractéristique commune de provenir d’un autre milieu socio- professionnel. Une des clés de leur réussite dans le milieu agricole est leur intégration qui prend différentes formes : orientation scolaire, formation professionnelle et insertion dans les divers réseaux locaux.Toutefois, en février 2024, Coline Sovran, chargée de plaidoyer chez Terre de liens, rapportait que seul un tiers d’entre eux s’installait. (© Cédric Faimali/GFA) Des obstacles à l’installationL’association explique ce faible pourcentage par les nombreux obstacles auxquels font face les Nima lors de leur parcours d’installation. L’un des premiers est la méconnaissance du milieu agricole. Le CGAAER soulignait d’ailleurs dans son rapport qu’il est « indispensable d’adapter les dispositifs d’accompagnement de l’installation aux spécificités des profils de ces futurs actifs agricoles et à la diversité des projets qu’ils portent ». Les Nima rencontrent en effet des difficultés à l’obtention des aides et des informations utiles à leur installation, mais aussi aux moyens de production.Autre obstacle de taille : l’installation hors cadre familial. Elle représente des défis financiers et logistiques importants. Il s’agit de trouver l’exploitation collant avec son projet. Ces futurs actifs ne sont en effet pas forcément intégrés dans les territoires ruraux et ne peuvent donc pas avoir accès aux réseaux d’informations adéquats, notamment pour savoir si des exploitations vont se libérer. Les terres agricoles restent « difficiles d’accès ».Il faut aussi mobiliser des financements solides. « En moyenne, reprendre une ferme coûte 500 000 euros, dont 200 000 euros d’investissement foncier », relève Terre de liens. Pour faciliter leur installation et obtenir les fonds dont ils ont besoin, il n’est pas rare que les Nima se regroupent et rassemblent plusieurs projets d’exploitation.Par ailleurs, les Nima ne sont pas connus de leurs futurs collègues agriculteurs. Certains cédants peuvent être réticents à l’idée de transmettre à ces nouveaux actifs. « Pour un cédant ou un bailleur, il peut être peu rassurant de confier son exploitation ou ses terres à un “inconnu” qui n’a pas fait ses preuves, ou dont les parents ne sont pas des acteurs connus et reconnus de l’agriculture locale », relève le CGAAER. Une fois installés, ces nouveaux actifs éprouvent parfois des difficultés à s’intégrer dans leur territoire et auprès des autres agriculteurs qui les entourent.De la formation à l’installation, en passant par la recherche d’exploitations, à quels défis ont été confrontés Antoine, Delphine, Clarisse, Titouan, Gwenaël, Marion, Nicolas, Anne- Charlotte et Sophie, tous non-issus du milieu agricole, lors de leurs parcours d’installation ?(1) Rapport du CGAAER Adaptations de la politique d’accompagnement de l’installation en particulier vis-à-vis des personnes non issues du milieu agricoleDes profils diversIl n’existe pas un profil de Nima mais bien des Nima aux multiples visages. Il peut s’agir d’une reconversion professionnelle après une première carrière plus citadine, avec souvent la volonté d’un retour à la terre et une quête de sens comme pour Clarisse. Mais le Nima peut aussi être un jeune de tout juste 20 ans, comme Antoine, passionné par l’élevage. Il a toujours vécu en milieu rural et est « tombé dedans » quand il était jeune. Il a donc tout naturellement décidé d’orienter ses études supérieures vers une formation agricole.D’autres Nima arrivent un peu par hasard en rencontrant la personne qui va partager leur vie. En plus de tomber amoureux d’un ou d’une conjointe, ils tombent aussi amoureux du métier d’agriculteur. Pour Delphine, qui s’est installée hors cadre familial avec celui qui est devenu son mari, la passion pour l’agriculture ne s’est jamais éteinte, même après vingt ans de métier.Leur point commun à tous est l’aspiration à une meilleure qualité de vie. En s’installant, ils désirent atteindre un équilibre entre vie personnelle et professionnelle encore peu présent dans le milieu agricole.