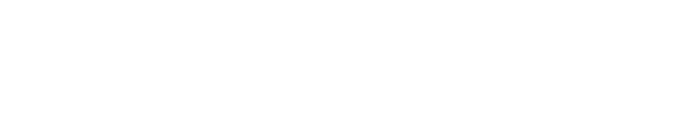Clarisse, Titouan et Gwenaël ont choisi de se réorienter dans l’agriculture pour donner davantage de sens à leur vie professionnelle. Venant à l’origine de l’ingénierie et du graphisme, leur chemin pour tenter d’obtenir des terres s’avère éprouvant.
«En quête de sens dans mon travail, je me suis intéressée à l’agriculture de façon un peu naïve, par un premier stage en maraîchage en 2018 », commence Clarisse Podesta. Quelques années plus tard, après avoir mûrement réfléchi son choix au cours de plusieurs expériences dans le secteur agricole, elle décide de se lancer dans la recherche d’une exploitation à reprendre aux côtés de Titouan Arnold. Ils se projettent dans une boulangerie paysanne en bio avec grandes cultures et transformation des céréales à la ferme.Pour « compenser l’entourage familial dont bénéficient souvent ceux qui sont issus du milieu agricole », ils choisissent rapidement de ne pas s’installer seuls et sont rejoints par Gwenaël Fradin qui porte, lui, un projet de maraîchage diversifié. Formations, stages, veille foncière, visite d’exploitations, candidatures : commence alors un véritable parcours du combattant, avec comme objectif ultime la reprise d’une exploitation. Les futurs associés envisagaient de reprendre une quarantaine d’hectares pour cultiver des céréales et une activité de maraîchage. (© Gwenael Fradin) Manque d’accès à l’information« Les terres agricoles sont difficiles d’accès. Un des obstacles rencontrés en tant que Nima, c’est que nous ne sommes pas sur place dans les territoires ruraux. Donc on ressent un grand manque d’accès à l’information. Parfois les reprises se prévoient des années à l’avance, certains futurs cédants sont approchés très rapidement par leurs voisins, ce n’est pas simple d’en être informé », soulève Clarisse. Il y a du foncier qui se libère, des agriculteurs qui partent à la retraite, mais il n’y a pas d’outils ou de politique de visibilisation, ni de stratégie massive d’aide à l’installation », exprime amèrement Titouan.Si la Safer et la DDTM (1) ont pour obligation de rendre les achats et autorisations d’exploiter publics, les délais de publicité sont en revanche très courts, « seulement quinze jours pour la Safer », ce qui permet difficilement de présenter une candidature avec des prévisions économiques.Après des formations et expériences agricoles entamées dès 2020, « on a vraiment commencé notre recherche de foncier en janvier 2023 », expliquent les porteurs de projet. Leur annonce de recherche a été diffusée par de nombreux réseaux. Or, partout, le même constat : « L’annonce n’a rien donné de spécial, c’était plus à nous d’aller consulter. »Un parcours semé d’obstaclesÀ côté de leur emploi à mi-temps, ils consacrent la majorité de leur temps aux recherches : le Répertoire départ installation (RDI) de la chambre d’agriculture, les annonces des réseaux Agrobio en Ille-et-Vilaine, celles du Civam, de la Confédération paysanne, Terre de liens ou encore les publications Safer et demandes d’autorisation d’exploiter de la DDTM.Dans leurs critères de recherche : « Un minimum de 50 hectares, dans un périmètre de 20 kilomètres autour de Rennes, et on souhaitait absolument qu’il y ait un logement dans la ferme, un critère qui complique » encore davantage leur cas, révèle Clarisse.https://www.dailymotion.com/video/x9ec1xiAprès avoir déposé un dossier de candidature pour une ferme agricole bio qui s’apprêtait à partir à l’agrandissement, ils obtiennent finalement l’autorisation d’exploiter en juillet 2024 grâce au schéma directeur de la région qui instaure une priorité pour l’installation et le bio.Avec le cédant, ils se mettent d’accord pour une vente intégrant l’ensemble du parcellaire et des bâtiments, par le biais de la Safer, afin de bénéficier d’un dispositif de portage foncier durant deux ans, « le temps de réunir le financement ». Fin janvier, le trio apprend malheureusement que le cédant ne souhaite plus vendre l’habitation ainsi qu’une partie du corps de ferme, une décision qui remet en question l’intégralité de leur projet. L’installation, initialement prévue pour juillet 2025, n’aura finalement pas lieu.« La Safer n’a pas été pédagogue avec notre cédant sur les implications de la transmission, déplore Clarisse. Le logement est un vrai point d’achoppement. Autour des grandes villes, l’immobilier est de plus en plus cher. L’enjeu consiste aussi à ce que les cédants arrivent à se reloger mais, pour nous, c’est important de pouvoir vivre sur place, pour les astreintes, les trajets, le rythme de vie. »Être crédible en tant que NimaAu cours de leurs recherches, la question de la « légitimité » a constitué une difficulté supplémentaire. En dépit du fait que chacun ait suivi une formation BPREA (2) ponctuée d’expériences agricoles, tous trois sont « surpris » par l’exigence des cédants. Titouan, Clarisse et Gwenaël visitant la ferme qu’ils projetaient d’acheter. (© Clotilde de Gaillard) « Ce n’est pas simple d’être crédible en tant que Nima. On ressent une crainte des cédants, qui se considèrent responsables de ce qu’il va se passer sur l’exploitation après leur départ. Ils peuvent avoir peur d’installer des personnes qui ne resteront pas dans le temps, et exigent d’importantes preuves de rentabilité. » Une « posture compréhensible du fait de leur attachement à l’héritage familial », selon Gwenaël. Auprès des institutions officielles également, il faut parfois « insister pour se faire écouter », complète Titouan.« Le jugement que peuvent porter des personnes sur notre recherche n’est pas toujours facile à vivre, confie Clarisse. La période de recherche reste très inconfortable, parce que tant que l’on n’a pas de foncier, on ne se sent pas forcément pris au sérieux. »(1) Direction départementale des territoires et de la mer(2) Brevet professionnel de responsable d’entreprise agricoleConvaincre son banquier pour financer son projetLa majorité des porteurs de projets hors cadre familial sont confrontés à « un mur bancaire », explique Benjamin Roudière, gérant du cabinet Agricourtage, spécialisé en solutions de financement agricole.« Un des points essentiels consiste à bien travailler en amont son plan de financement. Ce n’est pas parce que le prévisionnel est viable que la banque acceptera de financer le projet. La personne est le premier aspect regardé par les banques : a-t-elle suivi des formations ? Quelle est son expérience agricole ? Prévoit-elle des solutions d’accompagnement et de suivi du travail ? Il faut amener des éléments pour rassurer la banque. C’est la somme de tous les petits détails qui permet d’optimiser les chances de faire aboutir le projet. »Enfin, le portage foncier peut débloquer certains projets de reprise à un tiers, en permettant d’alléger le montant total à reprendre.